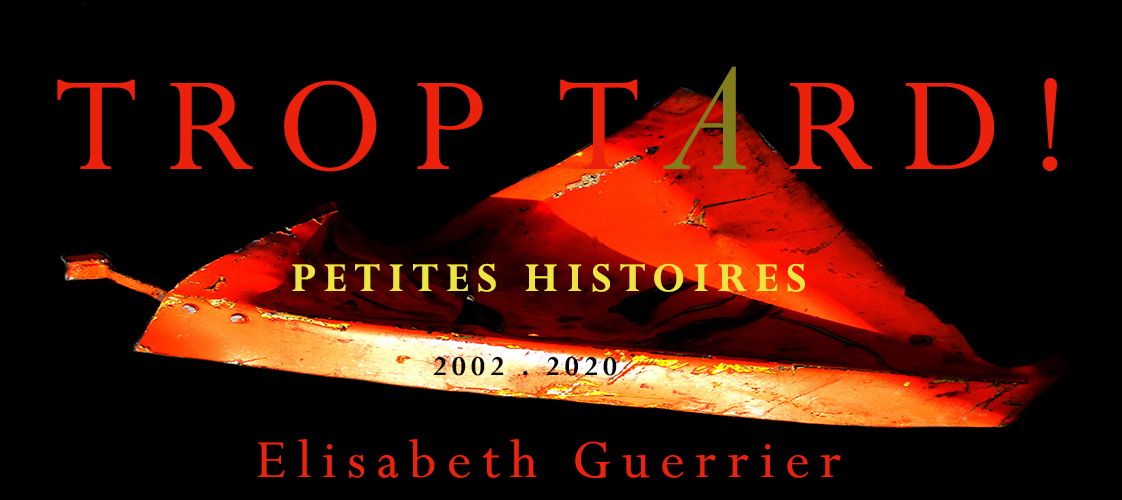Une nouvelle
fois, elle n’est allée nulle part.
La poignée de son cartable serrée dans le poing
droit, l’emploi du temps plié dans la main gauche, elle a monté des escaliers,
longé des couloirs, descendu des escaliers, remonté des escaliers, tourné à
gauche puis marché, puis tourné à droite.
Elle s’est arrêtée
plusieurs fois, posant le cartable en équilibre sur le sol entre ses mollets et
a ouvert l’emploi du temps pour vérifier encore une fois le numéro de la salle.
Depuis le début
du mois d’octobre, elle arrive à l’université chaque jour une heure avant le
début des cours pour se donner largement le temps de se perdre.
Et aussi, elle
l’espère encore, celui de se retrouver.
Depuis le début
du mois d’octobre, elle n’a réussi à assister qu’à deux cours.
Par une sorte
d’heureux hasard, elle s’était retrouvée face au bon numéro donc à la bonne
porte et elle n’avait plus alors eu qu’à pousser et entrer.
L’effet d’étrangeté
de ce quasi miracle avait cependant entravé ses capacités d’attention et elle avait
passé le cours à tenter d’élaborer des
stratégies pour réussir à revenir en cette même place la semaine suivante.
Mais la semaine
suivante, ça n’avait pas marché.
Chaque jour, les
étudiants passent à ses côtés, seuls, groupés, à deux et semblent tous savoir vers
où ils se dirigent.
Leur aisance la sidère,
comment et surtout où la trouvent-ils ?
Comment font-ils
pour se retrouver ?
Est-ce le fait de savoir où ils sont qui les rend si détendus, si confiants, chez eux, en quelque sorte, chez eux ?
Est-ce le fait de savoir où ils sont qui les rend si détendus, si confiants, chez eux, en quelque sorte, chez eux ?
Pour sembler
prise dans le mouvement de ceux qui savent où ils vont et comment s’y rendre, c’est
ce qu’elle fait, elle fait comme si elle savait vers où elle se dirige.
La tête haute
assez, l’air le plus dégagé possible, calme en apparence même si ses organes vibrent
tous sous les effets des tensions diverses qui la parcourent de part en part et
semblent lui ouvrir le chemin, éparpillés sur le sol vétuste des couloirs.
Elle se sent
condamnée aux couloirs.
Enfermée dehors
alors que tout ce qui l’amène ici devrait se trouver dedans.
Elle a même préparé
pour se justifier, des réponses qu’elle ressasse en marchant, au cas où quelqu’un
brusquement s’intéresserait à elle et lui poserait des questions sur sa
présence, sur ses projets, sur ses études.
Elle tentera de
citer quelques-uns des cours inscrits sur son emploi du temps.
Auxquels elle
n’a jamais pu assister.
Mais il est des
choses qu’elle ne dira jamais.
Qu’elle est
restée hier et le jour précédent et le jour précédent le jour précédent plus de
quatre heures d’affilée assise dans le foyer de la faculté de lettres.
Que c’est le
seul lieu dont elle trouve l’accès facilement.
Entrée, escalier, rez-de-chaussée, porte à gauche.
Entrée, escalier, rez-de-chaussée, porte à gauche.
Qu’elle cherche
à comprendre ce qu’est vraiment la littérature mais qu’elle ne peut pas
comprendre comment les couloirs et leurs salles y mènent.
C’est beaucoup
trop confus.
Les quelques
lieux stables, jalonnant cet égarement quotidien, le foyer, la chambre, le
réfectoire, qui lui restent en mémoire, emplissent à peu de choses près tout ce
qu’elle sait de son existence depuis qu’elle a quitté le domicile de ses
parents pour venir étudier dans cette ville universitaire.
Ce sont les
seuls éléments crédibles qu’elle pourrait relater ou plus simplement se
remémorer si elle devait témoigner de sa vie.
Car entre ces
lieux-là, identifiables, s’embrouille tout le reste et le reste, ce n’est pas
facile de se l’avouer mais c’est tout.
De jour en jour,
malgré tous ses efforts, elle se perd partout.
Elle a même
l’impression déroutante d’être plus égarée maintenant qu’au moment de son
arrivée.
Les tous
premiers jours, elle y croyait encore tellement, portée par son enthousiasme,
qu’elle avait pris un peu à la légère ces premiers pas vers nulle part.
Maintenant,
c’est autre chose, elle sait qu’elle est perdue.
Qu’elle
est constamment perdue.
C’est
ça qui complique l’accès à tout le
reste.
Le bâtiment de
la faculté de lettres n’est pourtant qu’un cube.
Un peu allongé
avec trois entrées, une à sa gauche une au centre et une dernière sur son
extrémité droite.
Il y a plusieurs
étages.
Trois.
Voilà, c’est
tout ce qu’elle sait.
Une fois une des
portes franchies, et elle a tenté de pénétrer dans ces lieux par les trois, elle
ne reconnait plus rien.
Rien de connu.
C'est-à-dire,
l’espace devient immédiatement incompréhensible.
Elle prend
chaque jour du temps pour se rassembler, pour se frayer un chemin à travers les
chiffres et les angles.
C’est un maquis.
En béton, des
affiches, des informations partout sur les murs.
Chaque jour,
elle lit attentivement sa fiche d’emploi du temps, le numéro de la salle.
356 et 216 et
104 et d’autres.
Et elle part.
Bien sûr, elle
doit l’admettre, les échecs répétés pour atteindre enfin les lieux où ceci,
qu’elle convoite depuis si longtemps, se passe, pondèrent un peu sa vigueur.
Elle ne se sent
pas encore complètement perdante, elle se sent de plus en plus perdue.
Elle continue de
chercher jour après jour à pénétrer là où elle trouvera enfin ce qu’elle vient
chercher et dont elle se pensait si avide.
Mais au fur et à
mesure que le temps passe, cet espace
avec lequel tant d’autres semblent ne
faire qu’un ne lui semble pas devenir plus accessible.
Plutôt moins,
d’ailleurs.
Elle monte les
escaliers qui doivent finir par la mener quelque part.
Elle arrive
quelque part, ouvre les portes battantes.
Ça devrait être
là.
Elle regarde les
numéros sur les portes.
Mais c’est
ainsi, ça ne marche jamais.
Est-ce à cause
de l’escalier ?
Est-ce à cause
des couloirs ?
Des
étages ?
Est–ce le bâtiment
lui-même ?
C’est ici mais
aussi tout autour que tout est noué, tout l’espace, la ville dehors, l’espace
illimité.
Avec ses
classeurs où rien n’est écrit, elle a toujours un livre dans son cartable.
Un livre pour
elle seule.
Qui ne pourra
jamais être, évidemment, un outil de travail.
Mais c’est un
livre tout de même, qu’elle emmène et qu’elle ouvre lorsqu’elle se replie, une
fois le découragement suffisamment massif pour la pousser irrémédiablement à abandonner
la porte 212, qui aurait dû être là, à gauche, en face du panneau d’affichage,
et qui n’y est jamais.
Un livre qu’elle
ouvre lorsqu’elle a rejoint le seul lieu où elle peut s’installer en sachant où
elle se trouve.
Abandonnant
toutes les autres portes, les autres salles, tout ce qu’elle n’a pu atteindre
et franchir pour trouver, derrière le mystère de leur localisation, l’agora
sacrée où parlent ceux qui savent et d’où écrivent ceux qui écrivent.
Elle a toujours un
livre, un roman, un essai, quelque chose qui la rapproche de ce qu’elle recherche
et qu’elle emmène de sa chambre avec elle chaque jour comme son radar.
Un livre comme
ce qui reste peut-être possible, pour oublier qu’elle ne sait pas encore
comment ni pourquoi elle se perd.
Pour pouvoir
toucher de la littérature malgré tout, même sans les cours.
Puisque les
cours la manquent.
Lorsque c’est
encore une fois trop tard, qu’après avoir descendu, monté une fois de plus, lorsque
sans elle les portes se sont toutes refermées et qu’ils sont tous en train de
noter les mots de l’esprit qu’elle ne sait
pas où trouver, elle descend.
C’est le seul trajet
sûr qui s’impose et qui la mène enfin là où elle se retrouve.
Vers le seul
lieu où elle se reconnaisse.
Elle descend et
ouvre les portes du foyer.
Puis dans le
bruit clinquant des flippers, l’odeur du café et de la nonchalance, elle s’assoit.
Chaque fois, cet
endroit et ce mouvement l’apaisent.
Il y a une
perte, un abandon encore mais ici, au centre de cette pièce aux murs décrépis,
au moins elle sait qu’elle est là où elle est.
Il y a plusieurs
mois, lorsqu’elle était encore une lycéenne tendue à l’approche du saut final, lorsque
tout était encore simple, les chemins semblaient tous mener quelque part.
En fait, elle
prenait toujours les mêmes, depuis des années et qu’il puisse en exister
d’autres, ceci non plus elle ne le
savait pas.
L’espace autour
d’elle lui était tellement familier qu’elle n’avait jamais même envisagé qu’il
était codé et que ce qui le balisait puissent être des signes qui lui était
adressés.
Qu’elle devait
savoir traduire.
Elle allait et
venait.
Ou plutôt, elle
sortait et rentrait.
Liée par un
cordon lisse et imperceptible qui la ramenait chaque jour aux mêmes lieux au
centimètre près.
Son temps, tout
pareil, mesuré à la minute près.
Elle enchaînait
les unes aux autres les activités en appuyant avec vigueur sur les pédales de
sa bicyclette puis rangeait sa bicyclette dans le garage et c’était fait.
L’exploration du
monde s’était limitée au cercle dont la maison était le centre.
Mais elle
l’ignorait.
Elle ignorait
qu’il existe bien d’autres choses que des rayons à suivre pour se trouver
partout comme chez soi.
Dans ce bâtiment
inconnu, dans cette ville inconnue, elle n’a aucune autre figure qui puisse la
conduire hors de cette circonférence où elle continue de tourner sans en avoir
la moindre conscience.
Le reste,
ailleurs, dehors, tout ce qui la cerne mais s’ouvre sur un infiniment vaste
incompréhensible, est illisible.
Elle doit
pourtant s’y aventurer, elle doit malgré leur morphologie impénétrable s’approcher
de tous ces lieux, y entrer parfois.
Elle est là
depuis deux heures, assise sur une chaise, entourée par les rires er les
glapissements des étudiants qui semblent se déplacer portés par l’air autour
d’eux.
Elle a encore
échoué.
Salle 340.
Ou une autre.
Il arrive
toujours un moment où ce qui l’emporte sur l’important c’est : qu’importe.
Un moment où la
tension du désir qui la soutient s’affaisse.
Elle a atteint
le premier étage, a marché d’une extrémité du couloir à l’autre en observant
attentivement les numéros des salles de chaque côté du corridor, elle est
revenue sur ses pas, n’a pas pu trouver
la salle 340 alors elle a décidé de descendre parce que cette salle se trouve
peut-être à l’étage inférieur, s’est alors aperçue qu’elle est revenue au rez-de-chaussée.
Alors, porte
après porte, le long du couloir du rez-de-chaussée, elle a cherché encore la
salle 340, civilisation et littérature médiévale, porte après porte, pensant
que peut-être, aujourd’hui, on ne sait jamais, tout en étant certaine qu’elle
ne la trouverait pas, puis elle est remontée à l’étage, a marché d’une extrémité
à l’autre du couloir, a cherché la salle 340 à nouveau, porte après porte.
Puis elle est
encore une fois descendue.
Et là, elle a
abandonné.
Presque
vingt-cinq minutes de marche et quelques arrêts l’ont ramenée face à la réalité
sans fard du seul lieu où elle est certaine de pouvoir entrer.
À cette heure,
le foyer est presque vide.
Elle y est
entrée avec une sensation de soulagement.
Toujours,
sentant que dans cette distribution des capacités, cet accès libre au mouvement
qui s’oriente sans peine, elle est dans l’incapacité de pouvoir demander à
quelqu’un, ici ou ailleurs, de lui expliquer enfin comment ça marche.
Comment il
arrive à marcher.
Elle sent dans
cette errance que rien ne vient cadrer, que rien ne vient stopper pour
l’arrimer à ce qui semble pourtant des bornes d’ancrage partagées par tous, que
quelque chose défaille, qu’elle défaille.
Ou plutôt que
quelque chose n’a pas été construit, des liens, des points de jonction alors
que les autres qui vont et viennent, semblent pouvoir s’installer là où est
leur place parce qu’ils connaissent des correspondances qui les y conduisent et
qu’elle ignore.
Dont elle ignore
jusqu’à la nature même.
Ce sont ses deux
seules certitudes, la porte du foyer et l’impossibilité de demander de l’aide
pour comprendre comment trouver les autres portes.
Le reste est
presqu’effacé sous sa propre impuissance à apprécier à sa juste ampleur la
désorganisation qui la condamne depuis quelques mois à l’égarement, attachée au
piquet de cette salle commune qui reste son seul repère.
Tous les autres
autour d’elle semblent naviguer avec confiance dans ce milieu qui lui reste
étranger, où elle se sent condamnée à demeurer pour toujours une étrangère.
Mais elle ignore
que cette épreuve de l’exil ne provient pas de ce bâtiment mais d’elle-même,
ça, elle l’ignore.
Elle ignore
comment mesurer son degré d’étrangeté.
Elle sait par
contre que ce qui, en même temps qu’à cette géographie, la relierait à ses
congénères lui manque également.
Impossible
d’identifier ça, une sensation évanescente mais qui ne la quitte pas et la met
sourdement en danger qu’elle se dirige vers la droite, la gauche, qu’elle monte
ou qu’elle descende.
Sauf sur cette
chaise, assise et sage, immobile dans un lieu immobile.
Lisant, à plat
sur la surface, enfin détendue et en sécurité.
Elle sait que la
civilisation et la littérature médiévales se dérobent chaque jour un peu plus sous
l’insécurité de ses pas.
Elle sait que
les bruits et les mouvements incessants du foyer la rendent peu à peu sourde à
ce qui semble pourtant lui être le plus cher.
Mais elle a été
lâchée seule dans le Mystère, sachant qu’il lui était impossible de simplement
demander, à quiconque, ici, à quiconque là-bas, comment ça marche, ou ce qu’elle
devrait s’appliquer à comprendre et à faire pour que ça marche mieux, il
faudrait qu’elle puisse dire, voilà qu’elle ne comprend pas parce que rien
autour d’elle ne lui désigne la direction à prendre, route, chemin, voie, rien
ne s’ouvre des traces qu’elle devrait identifier et suivre.
Des voies, c’est
ce qui les tire, comme des aimants vers d’autres places.
Ils ne partagent
pas le même sol.
Celui sur lequel
elle marche était un sol insensé.
Elle passe et
repasse devant des blancs.
Les corridors se
succèdent.
Les rues se
succèdent.
Mais il leur
manque un centre.
Partant d’un
seul centre, elle aurait certainement pu s’acheminer n’importe où.
Mais dans cette
ville, dans l’université, les centres sont multiples, mouvants.
Elle cherche à
tracer des cercles autour de ces centaines de points mais rien ne les relie les
uns aux autres.
Elle se condamne,
par la force de ces choses fuyantes et rebelles à sa maîtrise, à ne se déplacer
que sur des pistes connues, le chemin goudronné qui mène à la résidence
universitaire, les globes qui le jalonnent jour et nuit, l’accès au restaurant
qui est à mi-chemin.
Un chemin le
long duquel elle s’est attachée et auquel se résument ses explorations, toujours
les mêmes, bâtiment, égarement, foyer du bâtiment, retour au restaurant
universitaire, retour à la chambre.
Ailleurs,
les haut, bas, droite, gauche, tout est
dispersé dans une sorte d’explosion aberrante, sans que quoi que ce soit ait
été rassemblé jamais avant cette explosion, à sa connaissance, à sa
connaissance du moins.
Une explosion
sans début ni retour au calme des ordonnancements.
Sans ligne qui
puisse joindre les morceaux épars, sans qu’elle puisse se joindre en quelque
point que ce soit à ces morceaux épars.
Lorsqu’elle
quitte ce chemin de halage, elle s’épuise à s’orienter sans succès dans des
espaces disséminés et évidemment hostiles.
Elle sent de
jour en jour disparaître dans le vide qui bée devant elle son temps, son
énergie, tout son potentiel de travail.
L’idée du mot lui-même,
la littérature, qu’elle retenait comme une bouée, accrochée, accrochée pourtant
encore de toutes ses forces, aurait pu
la faire éclater en sanglots.
Elle le voit
s’estomper, se fondre dans l’horizon bouché des seuls quatre murs couverts de
graffitis et d’affiches où elle se retrouve chaque jour.
Elle sent
pourtant confusément parfois la présence derrière elle d’un système.
Des
enchaînements, des logiques, qui restent dans son dos lettre morte.
Lettre morte,
elle plie la nuque sous le poids de sa désillusion.
Elle pensait
tant, avant, que tout ce monde bruissant des phrases et de leur tournure, que
ce monde inépuisable des mots lui était acquis, familier, elle pensait pouvoir
si facilement y être à demeure que la nécessité de devoir matérialiser dans un
couloir, dans un numéro de porte leur accès ne l’avait pas même effleuré.
Elle pensait
qu’à la mesure de son plaisir et de ses dispositions à les absorber, allait
s’ouvrir en grand, sans essai, sans effort, que son accès était déjà prêt, vers
l’entrebâillement de leurs arches et leurs clefs.
C’était pour
elle une évidence, une sorte de principe depuis si longtemps, son appartenance.
Dans ses
passages à vide, ses passages à blanc dans les corridors mutiques, elle a aussi
perdu sa raison.
Sa raison
d’être, le sérieux et l’attention qu’elle se devait de donner à leur étude.
Tous ses héros,
ses pages dévorées la nuit sous le secret des couvertures.
L’étranger.
Les mains sales.
Allant et
venant, emprisonnés indéfiniment dans les invisibles forteresses du campus.
Fermée la porte
et l’évidence de cette terre de grâce où s’enfoncer.
Fermée par
déficit, par perte dans de grands espaces sans tenue pour la retenir.
Parfois
pourtant, elle essaie, elle essaie, tout son corps se tend, sur le qui-vive,
comme enfin prêt, et quand elle s’est assez perdue, que tous ont rejoint leurs
bancs solides, il lui arrive de rester dans le couloir vide, debout devant une
porte fermée, au hasard, écoutant les voix graves résonner dans des amphithéâtres
qui restent inaccessibles.
Car aucun mot ne
parvient à lui ouvrir les arcanes de ce pour quoi elle aurait donné, il y a
quelques temps, son temps, tout son travail, tout, tout son temps si elle ne
l’avait pas perdu comme ça, à chercher à se tenir en équilibre dans un espace
sans marques.
La vivisection
de la langue.
Chateaubriand.
Céline.
Colette.
Elle tente çà et
là de capter un signe, une indication qui la ramèneraient à l’intérieur du
périmètre sacré de leurs intimités.
Derrière les
portes fermées, elle sait qu’elle aurait nagé elle aussi, appliquée, tenace,
peu apte à suivre aisément les courants peut-être mais besogneuse.
Mais elle est entrain
de baisser les bras, ne transpire plus que sur la feuille froissée de son
emploi du temps, où les gouttes tombent
juste entre les numéros de salles et les intitulés des unités
pédagogiques.
L’unité, voilà
ce qui lui aurait permis de s’orienter.
À divaguer ainsi
d’une erreur à l’autre, à se perdre dans ces couloirs pour lesquels maintenant elle
commence à éprouver un véritable dégoût, elle se rend compte qu’elle a éparpillé
certaines parties d’elle-même, que vraisemblablement cette dislocation la
précède.
Il y avait eu une
salle 108 où avaient lieu les travaux dirigés de langue vivante.
Une salle 213 où
elle aurait dû découvrir les trésors de la sémiotique.
Mais elle est
restée quelque part entre les deux où ne s’enseigne rien.
Si l’illusion de
sa cohésion ne la porte plus, elle
continue, même tendue à craquer pour se conserver, même presque nauséeuse,
malgré tout, de chercher.
Bien sûr
lorsqu’elle reçoit un appel en provenance de sa famille, elle dit que tout va
bien, qu’elle a beaucoup de travail.
Là non plus elle
ne peut rien demander, la laisse qui l’a tenue à tourner et tourner autour d’un
même piquet fiché dans la supervision sans faille de tout son temps et de tout
son espace pend maintenant à ses pieds.
Et ni sa
famille, ni elle-même n’ont pris garde
au changement.
Elle se retrouve
autre et inconnue, il ne lui sert plus à rien de tirer sur son lien pour en
retrouver l’origine puisqu’il est coupé net.
Toutes ces
années, elles les a passées à se laisser les yeux fermés hisser au-dessus des
plans et des cartes sur lesquels d’autres s’orientaient pour elle.
Les autres, qui
vous tiennent éloigné du sol, à qui vous devez rendre des comptes et abandonner
vos empruntes.
Elle se
contentait d’obéir aux ordres venus de la terre et maintenant il n’y avait plus entre la terre
et elle qu’un néant insaisissable où personne cette fois ne lui indiquerait où
poser les pieds ou ne les poserait à sa place.
Se tenir à son
sac ne suffisait pas.
Alors elle se
tient à son livre.
Elle s’oublie
dans quelques-unes des pages que d’autres, encore d’autres, ont écrit pour
elle, levant la tête de temps à autre pour se confronter à ses pairs, hilares,
studieux, semblant si légers et en même temps si tenaces à suivre la direction
que prennent les courants.
La salle est
sûre.
Ce qu’elle ne
sait pas non plus c’est qu’à cette perte s’attache une peur, mauvaise, obtuse,
qui la tient comme penchée vers l’avant à chaque heure de la journée.
Elle n’en sait
que l’état de pesanteur et la fermeture.
Elle bafouille
et s’immole dans un complet silence.
La distance à
franchir pour accéder à ce qui semble vivant est incommensurable.
Elle a laissé
là-bas, dans cette maison où gouverne sa famille, la fille hilare et active, la
fille aux rêveries exquises, celle qui écrivait comme on dort.
Elle l’a laissée
et rien n’est venu prendre sa place dans cette foule bruyante dont elle ne
comprend pas la langue.
Rien n’est venu
la guider pour la remettre à l’ordre des jours.
Elle ne se
reconnait pas.
Elle ne s’y
reconnait pas.
Alors elle lit
et lit sans mesure à travers les mots qui l’ont abandonnée, cherchant à
dévoiler sous les traces laissées par d’autres l’organisation immuable des
choses.
Elle lit pour pouvoir
aller ailleurs en se faisant accompagner.
Pour retrouver,
dans les images abruptes de ceux qui ont mouillé de leur sueur les atlas qui
dessinaient leurs territoires, un peu de sa main mise, de son ancien pouvoir à
s’exiler sans s’oublier, quand elle prenait un cahier et que les signes s’y
inscrivaient comme mus par une force de propulsion étonnante qu’elle considérait
comme une évidence.
Expatriée,
éjectée, elle lit entre les lignes de ceux qui ont su délimiter les contrées de
leur perception et leur dessiner des bords à coup de métaphores et de verbes
d’action.
Régulièrement, elle
lève le front et regarde le temps passer sur l’horloge suspendue au mur
derrière le bar.
Elle croise
maintenant certains visages qu’elle commence à reconnaitre, qui lui adressent
quelques signes auxquels elle répond.
Une familiarité,
un confort qui ne s’est reconstruit nulle part ailleurs, elle est chez elle
dans le foyer de la faculté de lettres.
Comme chez elle.
Elle n’est chez
elle que dans le foyer de la faculté de lettres.
C’est le seul
morceau d’espace qui ait conservé intact encore les traits de son rêve d’avant.
Le seul endroit
où elle puisse se déplacer en sachant à peu près où elle s’avance.
Dans les
quantités de garçons et de filles qui vont et viennent, elle a noté la présence
d’un étudiant qui, à chaque fois qu’elle le croise, lui sourit.
Elle lui rend ce
sourire avec application.
Elle s’est
surprise à le chercher des yeux en s’installant après sa dernière escapade vers
nulle part, presque immunisée maintenant contre les suites un peu fébriles de
cet échec quotidien.
Tournant lentement
la tête vers ce qui la rassure et le croiser, ce type qui lui sourit, la
rassure.
Elle s’est aussi
surprise à se sentir déçue lorsqu’il n’était pas à sa place, près du flipper,
elle imagine, elle imagine, l’attendant.
Lorsqu’il a
traversé la salle presque déserte à cette heure de la journée et s’est approché
d’elle avec suffisamment de résolution pour qu’elle ne doute pas une seconde
qu’il allait lui parler, elle a senti sa chaise s’effondrer, le livre se
refermer sur ses doigts, sa langue s’assécher brutalement et l’envie de fuir,
de fuir de cette place forte qui la tenait pourtant si bien calée.
Mais c’était
trop tard, elle allait devoir répondre, se libérer de cette main serrée autour
de sa gorge en ne lui donnant à voir qu’une jeune fille normale.
Voilà où elle en
était, après toutes ces heures à constater qu’elle n’était nulle part, à
commencer à craindre de ne plus pouvoir jamais intégrer la souplesse et
l’évidence des échanges normaux, des promenades normales, des activités
normales.
Condamnée, elle
le craignait de plus en plus, à passer son existence entière sur cette chaise
dans le foyer de la faculté de lettres, lisant pour s’apaiser tous les
brillantissimes auxquels elle rendait un culte silencieux, le cerveau en feu, paralysée
pourtant dans toutes ses tentatives pour extraire d’elle-même quelque étincelle
que ce soit.
Il s’est donc
avancé et s’est présenté d’une façon très sérieuse.
Surtout qu’il ne
découvre pas à quel point elle se sentait soudain affreusement anxieuse.
Elle a essayé de
lui répondre en se demandant, entre deux battements de tympans et la répression
d’une espèce de hoquet si elle devait se lever, rester assise, se lever, rester
assise, se lever, jusqu’à ce qu’elle lance son nom dans l’espace entre eux
comme une bombe, de fabrication artisanale, mal ficelée assez pour qu’il doive lui
proposer de le lui répéter parce qu’il n’avait pas entendu.
Vertige,
souffrance insupportable, elle prononce à nouveau les quelques syllabes et se
mord les lèvres pendant qu’il approche une chaise de la sienne en lui demandant
la permission de s’installer à ses côtés.
Les mains
moites, elle se reprend, reprend son souffle, son air, et puis soudain, comme
par enchantement, poussée par son enchantement, saute au-dessus de la barrière
derrière laquelle elle est enfermée depuis quelques mois et commence lentement à
parler, à lui parler.
Les mots sortent
avec une sorte d’avidité, prennent leur autonomie, traversent l’air vers lui
comme si ils avaient été cloîtrés des mois, des années durant et ils l’avaient
été, même si ce n’était pas le moment de songer à cet enfermement, ce mur de
silence dans lequel elle errait depuis son arrivée.
Il semble
intéressé, répond à ses questions, lui pose des questions à son tour, ils
s’entourent, de petits fils qui se nouent, les uns après les autres entre eux.
Elle a la
sensation de soudain pénétrer à nouveau en terrain connu, elle se retrouve là,
assise à lui parler, elle rit, il rit, ils vérifient leurs intérêt communs et
sa langue se libère, reprend la forme des messages qu’elle a manqué d’envoyer
depuis si longtemps, elle ouvre à un léger vent ses passions, sa ténacité dans
ses passions, ne lui découvre rien d’autre que ce qu’elle pourrait palper comme
une sorte de fond de poche, sa poche, là où elle était rangée avant, lorsqu’elle
était encore sûre d’elle, de ses envies et de ses prérogatives.
Elle oublie
pendant quelques minutes le vague de ses décors, le vague de sa consistance
même dans ce mouvement qui l’entoure où elle a coulé.
Elle ne peut pas
aborder ça, ça n’a pas de sens, pas de sens pour lui et surtout pas pour
elle.
Que lui dire sur
quelque chose qui semble d’une telle évidence pour tous ?
Il n’a pas coulé
lui, il connait, semble-t-il, le bord des choses.
Il est ici chez
lui, partout ici, dans cette ville qui l’a vu naître, il est chez lui.
Puis il est
reparti, la laissant assise, immobile, soumise à une avalanche d’incrédulité,
une savoureuse incrédulité.
Celle des
retrouvailles inattendues, des fêtes improvisées.
Elle s’est
reconnue.
Elle a parlé comme
si elle était encore chez elle, là-bas, ignorante de la profondeur sans fin du
monde.
Puis elle est
repartie elle aussi, vers les postes qu’elle occupait sans faillir, sa place au
restaurant, sa chambre.
Mais celle qui
s’était déliée ainsi avec lui, elle l’a emmenée,
attendant, qui sait, quand elle aurait bien récupéré toutes ses fonctions
égarées dans le cosmos des études qu’elle ne pouvait pas faire, qu’il lui
permette de regarder au loin par-dessus son épaule.
Attendant de
cette rencontre quelque chose qui la sorte.
Lorsque quelques
jours plus tard il est revenu, elle continuait de lire mais elle avait
abandonné ses recherches matinales pour trouver la location des lieux saints.
Le foyer s’était
transformé depuis leur rencontre en un point de contact.
Pas certain,
non, mais possible.
Et elle s’était
installée là, à cette jointure entre le no man’s land entourant cette place où
elle se recroquevillait par force et ce qui pouvait, s’il revenait et s’il lui parlait
à nouveau, lui permettre de s’ouvrir.
Accompagnée, par
lui, qui sait, qui l’aiderait à sortir.
Le foyer avait
perdu sa fonction de piste d’atterrissage forcé pour devenir le point de départ
d’une possible échappée.
Elle n’avait
plus besoin de devoir s’y retrouver maintenant, quelque chose avait pris la
place, dans les bruits et les claquements de porte, les rires et la
nonchalance, elle ne cherchait plus à oublier l’imprévisible des espaces, elle
commençait à entrer sans le savoir dans l’imprévisible du temps.
Celui des autres.
Il avait soudain
ramené à lui seul l’essentiel de ce qui pouvait la tenir occupée, anticiper sa
venue lui fermait la vastitude.
Mais en échange
elle lui laissait ce qui allait devenir son terre-plein, sa matière, elle lui donnait
l’attente.
Les jours
suivant, elle a trainé ici et là, plus très bien sûre que quelque chose s’était
vraiment passé.
La lourdeur de
ses temps de prospection vaine s’est faite encore plus sensible.
Même l’air est
devenu aussi rare et dissipé dans le nombre de ses trajets quotidiens.
Elle est restée
en suspens, la bouche peut-être un peu ouverte, ne sachant plus que faire
d’elle-même ni de tout ce temps.
La chaise du
foyer a changé d’angle, son cou aussi, qui se redresse en lisant, qui ne lit
plus, qui attend.
Les raisons de
sa présence et sa volonté de se prendre en main, vaille que vaille malgré
l’opposition flagrante des éléments ont cédé place à quelque chose de plus
obnubilant mais de plus facile.
Elle a déménagé,
est passée de quelque chose qu’elle attendait d’elle à quelque chose qu’elle
attend de quelqu’un.
Puis au bout de
quelques jours, soudain, il est revenu.
Elle a cherché à
cacher que ça pouvait tout changer pour elle, qu’elle attendait et que grâce à
sa venue, sa direction se déterminait ainsi soudain plus aisément.
Il lui a
légèrement embrassé le front et lui a proposé de venir faire un tour avec lui.
Un tour.
Ils sont sortis
du foyer.
Non, ils ne sont
pas sortis, à ce moment a commencé quelque chose, qui devait devenir une
rambarde indissociable de sa sécurité, elle l’a suivi, elle a commencé à le
suivre.
Il marche à ses
côtés, presque collé à elle mais c’est elle qui s’adosse à lui.
Il a
certainement l’impression que tout est simple, qu’elle l’accompagne mais tout
en elle est hérissé par-dessus son épaule vers l’étrange.
Il lui sert de
brise-glace, il avance et bifurque, elle avance et bifurque, pouvant enfin dévisager
tous ces bâtiments avec une certaine distance. Il lui offre de quoi occuper
l’espace.
Il pense que
comme lui elle sait où elle va.
Elle ne lui dit
rien, rien encore de cette expérience qu’elle est en train de vivre à la fois
seule et grâce à lui.
Il lui ouvre
sans le savoir les brèches où elle peut enfin se faufiler, solidement attachée
à lui par la crainte de se perdre si elle le perd.
Il est devenu ce
tampon, cet intervalle plein qui lui manquait pour se reconnaître.
Il est la bonne
place, il la met à la bonne place, sans qu’il n’en sache rien et elle, bien sûr,
encore moins.
Elle discerne
juste que la teneur des choses autour d’elle prend sa place.
Elle sent que
cette déroute dans laquelle elle s’est trouvée ces derniers mois, cette
incapacité à se situer dans un monde inconnu, laisse place à des sensations
qu’elle retrouve.
Une légèreté,
une sécurité qui lui permettent de s’en prendre aux éléments sans se sentir
tomber en spirale dans leur absence de limites.
Il lui propose
d’aller prendre un verre, elle accepte et la porte du bar s’ouvre sur une
société instable, chaotique mais qu’elle pense devoir pénétrer à tout prix
parce qu’il la lui présente comme une évidence.
Toute la journée
se passe et la soirée et les journées qui se suivent et qui les emmènent ici et
là, toujours ensemble, ne se quittant pas, ne se quittant plus, se réveillant
ensemble pour s’endormir ensemble.
Elle a presque
oublié.
Ce qui l’a
amenée dans cette ville s’est effacé sous les pas qu’ils font tous deux le long
de ses rues.
Elle n’y pense
plus.
Elle n’a plus
besoin de savoir que les salles du bâtiment de lettres ont des chiffres, un
ordre, peu à peu, en allant de-ci de-là, installée derrière lui, elle abandonne
sans se le dire l’idée même que c’est là-bas qu’elle aurait fait ses études,
l’idée que rien d’autre n’avait, à part ces études, d’importance.
Tout a basculé.
Il a beaucoup à
faire et elle le suit.
Elle ne peut pas
même imaginer qu’elle pourrait se séparer de lui, s’en aller, aller, suivre son chemin seule.
Elle n’a accès à
aucun chemin seule.
Aucun, mais même
si elle ne se le dit pas par crainte d’en trop déchiffrer sur son compte, le si
étroit espace qui la sépare de lui à n’importe quel moment de leurs
pérégrinations pourrait, s’il ne se confondait pas avec un attachement, sembler
presque confiné.
Elle ne veut pas
le voir, elle ne veut plus jamais sentir peser les éloignements sans contour et
les gouffres sans relief des dislocations.
Elle a peur.
Encore, et ce
garçon qui la promène ainsi nuit et jour l’empêche de le savoir.
Il lui tient
tête et lui donne corps, c’est assez.
Elle se colle à
lui et s’accroche à ses branches et la fermeté qu’il lui donne la ramène aux
certitudes d’antan.
Elle navigue,
elle navigue à ses côtés mais l’ancre est profondément fichée dans le fond
vaseux de la peur des disjonctions.
Bien sûr elle
l’aime, il l’aime, tous les signes de ce qu’elle imagine devoir être l’amour la
libèrent des raisons plus discrètes de ce qu’elle a sacrifié, des raisons de ce
sacrifice, raisons ineptes, inqualifiables, qui ne la lâchent pourtant pas,
comme elle ne le lâche pas.
Elle est en
train de s’échapper.
Elle se quitte
peu à peu, ayant par ce tour de passe-passe échangé ses passions premières
contre ceci, avec qui elle croit advenir quand elle ne fait que combler derrière
elle les espaces béants de sa perdition.
Il est son
pilote, prend les décisions à sa place, sait sans hésiter où il va.
Il lui permet de
faire une économie conséquente.
Celle d’une
marche dans la vacance auquel elle devrait donner des noms.
Elle a laissé
sous les voûtes des lieux saints la part d’elle-même qu’elle aurait pu regarder
dans les yeux et reconnaître.
Pas tout de
suite, plus tard, les études sont longues, un chemin sinueux et exigeant mais
où, même assise ainsi dans ce bar à ses côtés, elle sait qu’elle devait suivre.
Parce que nulle part ailleurs, malgré le profond silence dans lequel elle a
inhumé ce qui la tient, elle ne s’entendra mieux avec elle que dans cette
confrontation avec les lignes, que dans l’enthousiasme intarissable de sa faim
et des mots de cette faim qu’elle a perdus en le laissant la guider.
Le temps est
toujours le plus fort, le plus long, le foyer lui aussi s’est vu déserté, une
autre vie, une vie de couple a progressivement pris la place de ce qui n’en
avait pas, appartement, amis, recherche de travail, sorties, tout loin de cet
immeuble aux yeux clos pour elle maintenant.
Elle n’y pense
pas, elle pense même que d’une certaine façon, elle a échappé à la révélation
de ses limites. Plantées au bout du chemin, résultats médiocres, efforts vains,
le rêve fondu sous la flamme des intelligences. Elle n’a pas vraiment idée de
ce qu’aurait pu générer de désillusion ce qui se tramait à l’intérieur de ces
salles, ni du sol particulier que cet enseignement lui aurait permis
d’arpenter.
Par contre, elle
sait qu’elle a aussi quitté des références, des outils, des méthodes.
Mais à ça, elle
n’y pense pas. Elle n’y pense pas parce qu’elle ne sait pas à quel point si
elle le savait tous ces matériaux maintenant hors d’atteinte semblerait lui
aller comme un gant, ou non, un gant un peu serré, qu’on enfile en faisant
travailler la peau tannée mais qui aurait pu envelopper sa main à la
perfection.
Ça, elle n’y
pense pas. Elle a effacé sous ses pas qui maintenant la conduisent sans
encombre d’un lieu à l’autre de la ville tous les autres trajets, toutes les ruelles
un peu sombres où elle aurait eu à apporter la lumière fuyante du travail.
Leurs noms, les
noms des auteurs qui l’avaient fécondée restaient comme suspendus au-dessus
d’elle mais elle ne se fraierait plus un chemin jusqu’en leur cœur.
Elle resterait une
amateure alors qu’elle était prête à entrer dans une spécialité comme dans une
vocation.
Le couple qu’ils
formaient depuis quelques mois menait sa vie, leur promiscuité incessante l’épuisait
aussi parfois, elle sentait que l’accrochage des premiers temps devenait plus
lâche, que toutes les marques dont il avait balisé son chemin ne menaient nulle
part maintenant qu’elle pouvait les repérer seule, qu’elle avait certainement
besoin de lest, elle ne se le disait pas, c’était impossible d’évaluer la
tension de l’attache qui la retenait à lui, elle pouvait lâcher et c’est ce qui
se produisit.
Pas en refaisant
la route à l’envers et en montant enfin l’escalier adéquat pour atteindre le
deuxième étage où étaient toutes les salles commençant par deux. Reprenant comme
à zéro mais pas complètement. Elle avait en le suivant, pris le temps de sa
maturation au sein des codes mystérieux du monde.
Non, elle ne
refit pas ce trajet, elle rencontra un autre homme, puis un autre qui comme les
savoirs dispensés dans des salles de cours, l’amenèrent à aborder à chaque fois
de nouveaux territoires.
Une vie, elle
faisait sa vie.
Non, sa vie la
faisait mais ça, elle ne le savait pas encore.
A Pierre 2003