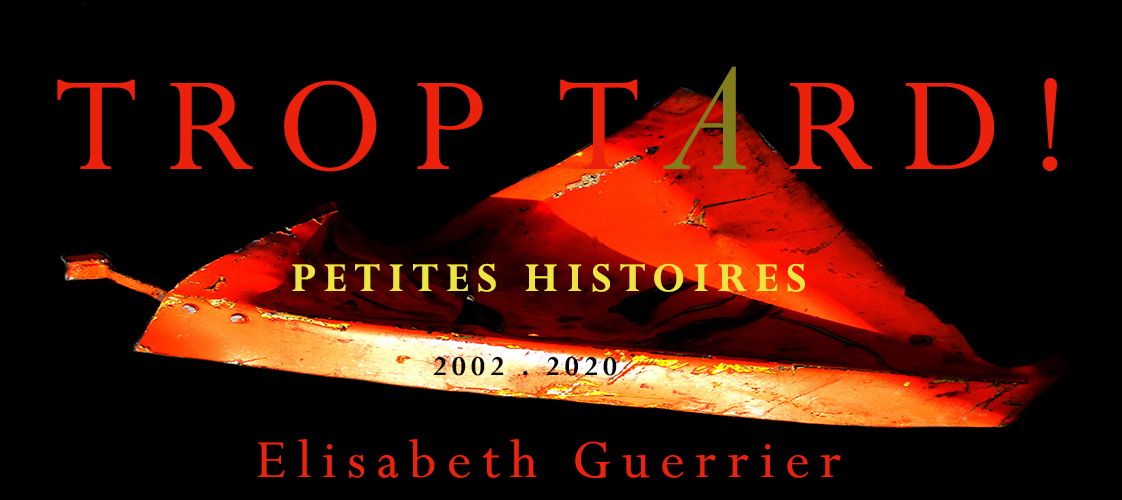La gamine
Les femmes de la
famille portent toutes au milieu du front leur paire de mamelles.
Ce sont leurs
seins qui les précèdent, traversent l’air, forcent l’espace.
Leur féminité
descend jusqu’à leurs ceintures, débordant à gauche, à droite sous leurs bras
lorsqu’elles les croisent.
Le volume de leur
poitrail est depuis toujours logé dans la rêverie domestique.
Il y occupe une
large place.
C’est une
légende, un prototype.
Le commun accord
génétique supposé traverser les générations de filles.
Des seins
survolant l’histoire.
Inamovibles.
Mais l’arbitraire
créatif de ses acides en décida autrement.
Pourquoi,
pourquoi là, justement sur le torse de la gamine ?
Assise sur la
branche de son noisetier, un carnet à la
main, elle réfléchit.
Pétillant sous
l’effet de sa réussite, les joues rouges.
Grimper, monter
sur tout ce qui s’élève entre elle et le vide du ciel.
Les rampes
d’escalier, les escaliers, les grilles qui ferment les jardins.
Les murs, les
rochers, les arbres.
Tous les arbres.
Réussir à escalader,
vite, le plus haut possible chacun des arbres à sa portée.
Son but se crée
au fur et à mesure des frottements.
Le lointain
n’existe pas.
L’arbre.
L’écorce devient
sa peau.
Elle et l’arbre.
Ses lombaires se
séparent aux intersections du tronc et des branches.
Attentive,
concentrée jusqu’à l’absence, aussi flexible que les rameaux de plus en plus
fins sur lesquels elle se pose.
Elle perd dans
l’ascension une partie de sa pesanteur.
Les craquements,
les éclats de mousse, les chuintements qui traversent les feuilles l’acclament
sur son passage.
Ils lui tiennent
tête.
Arbre.
Chez elle.
En haut.
Quand les femmes
s’activent en bas, chargées du colis jamais déposé de leur poids d’existence.
Beaucoup plus
bas.
La gamine habite
un corps sec, vibrant sous les secousses qui percutent le monde.
Elle absorbe les
chocs en y posant la paume des mains et les pupilles irritées de trop voir.
Son corps entier
est écartelé sous ses sens en excès.
Tout l’attache,
tout la touche.
Son corps entier
lâche des flux continus d’énergie qui lui reviennent, chargés des spasmes
imperceptibles en suspens dans l’atmosphère.
Elle est occupée
toute entière à faire passer les choses de l’extérieur vers l’intérieur.
Occupée tout
autant à rassembler les pièces collées à son larynx pour les exhiber sous la
lumière changeante des matinées interminables.
L’intense
application qu’exige cette passion d'être ne laisse aucune place aux compromis.
Qu’elle aura à
accepter pourtant.
La gamine, bien
sûr, devra, lorsque son tour viendra, s’aménager le corps.
Se quitter.
Mais elle n’y
croit pas.
Pas une seule
seconde.
Lorsque les
signes du destin réservé aux filles auraient dû la déprendre d’elle-même,
s’interposant entre sa peau et le monde chahuteur qu’elle traverse, la figeant
aux pieds d’un mur sur lequel elle ne pourrait plus jamais grimper, elle n’y a
pas accordé la moindre attention.
Elle échappera à
la malédiction.
Elle poursuivra
ses projets organiques.
La gamine passera
son temps à détourner les yeux.
Elle est
étrangère à la fatalité hormonale.
Cela ne la
concerne pas.
Ses activités ne
peuvent se développer pleinement que dans l’évanescence.
Son corps ne pèse
pas.
Son corps ne pèse
rien.
Il n’est que
l’intercesseur des étonnements sans cesse renouvelés que lui procurent toutes
les mobilités qui l’enserrent.
Évidemment.
Marcher pieds nus
sur la terre sèche.
Fermer fortement
les paupières pour traverser la viscosité du brouillard à la force de ses
mollets malingres pédalant, pédalant sans arrêt, d’une obligation éducative à
l’autre.
Les femmes la
forment.
Les femmes
emploient son temps.
La gamine le leur
a cédé, presque intégralement.
Livré à leur
méticuleuse gestion, elle leur a laissé l’ordonnancement de ses jours.
Mais elle a gardé
son corps.
Entier.
Par-devers le
règne des femelles grises, son corps a conclu des alliances et repousse
les recensements jusqu’aux extrêmes bords de ses journées.
Á leur insu, la
gamine s’étire jusqu’à ses confins, jusqu’à sa tombée dans l’épuisement du
soir.
Sa matière est
lointaine, détachée.
Suréquipée d’une
puissance tactile qui la monopolise constamment des pieds à la tête.
Matins glaciaux.
Étés ralentis.
Bruits, bruits,
lumières.
Fractions
tranchantes des évidences.
Tamis des nuages,
bourdonnement des trouées profondes.
Rugosités et plis.
Rugosités et plis.
Sable lourd.
Sable dense.
Sable cuisant.
Granit.
Graviers
violents.
Briques.
Boue.
Bitume fondant.
Feuilles mortes.
La plante de ses
pieds lui enseigne la vie.
Rochers immenses
où elle s’isole, s’exile loin des foules et s’enfonce toujours plus profondément
dans l’espace des grandes vacances, devenu plus ouvert et flexible.
L’apesanteur,
courir, sauter, courir, sauter.
Portée par les
matières changeantes.
Lichens
glissants, frottements.
Claque magistrale
d’une vague plus haute que les autres.
Langue salée qui
fait cracher le sable entre ses cuisses.
Son visage entier
s’agace sous la versatilité de l’air.
Ses pommettes
sont le thermomètre d’écarts illisibles.
Dans la même
pièce, sa peau absorbe comme une éponge la moindre variation de température, s’étire
et rougit sous les hasards climatiques.
Il lui manque une
épaisseur.
Là, sur la face
externe, quelques dixièmes de millimètres de peau supplémentaires qui la
maintiendraient bien enfermée à l’intérieur.
Abritée des
attouchements de l’air qui embrase ses joues.
Et ses lèvres.
Craquées,
craquantes.
Sèches jusqu’à
l’écartèlement.
D’un bout à
l’autre des saisons.
Petits sillons au
centre enflammé que le bout de sa langue essuie, suce, passant et repassant
comme un baume apaisant sur les minuscules fissures.
Rebords énervés
par la nécessité sans cesse reconduite d’ouvrir et de fermer la bouche, plus
vulnérables encore sous les rigueurs sans nuances de l’hiver.
Se déchirant d’un
coup en saignant.
Mains se guidant
sans répit sur les bords du monde matériel.
Ses mains sont
des verbes d’action.
L’extrémité de
ses doigts lui apprend à lire.
Doigts durs du
froid.
Actifs, précis.
S’apprêtant à
reconstruire, à défaire et redresser, à décoller, à s’accrocher, à s’enfoncer.
À se tendre au
fond des lieux encaissés et obscurs.
Gratter de ses
ongles cassés.
Peaux à vif sur
les cuticules, mordues, déchirées, avalées.
La gamine se
mange.
Tièdes, palpés
sous la moiteur des draps, hématomes et contusions.
Sur chacun des
genoux, le délicat dépouillement des croûtes soigneusement arrachées à peine
formées.
Son corps
disparaît en elle par morceaux.
Introduire
l’index dans ses narines humides.
En extraire de
minuscules résidus et les malaxer de longues minutes au bout de ses phalanges
excitées.
Épouser la terre
avec une ferveur telle que le ventre et les cuisses s’exaltent jusqu’au
fanatisme.
Son corps entier
est une empreinte.
Son corps entier.
Nez grand ouvert
aux vents engorgés de feuilles en voie de putréfaction.
Odeurs
magnifiques et insupportables.
Violentant son petit
cerveau.
Son olfaction
toute puissante la tétanise.
Elle y stationne,
la langue coupée par le tranchant d’arme blanche des groseilles à maquereaux.
Son corps
s’effrite dans les écailles de la peinture
qu’elle décolle, entasse en petit cônes puis écrase le plus finement
possible au creux de sa main.
Son corps est
gratuit.
Dans chacun des
gestes qu’il effectue se glissent de grands chambardements invisibles à l’œil
nu.
Elle ne nomme
rien.
Elle entend tout.
Les pulsations de
l’air vomissant de chaleur.
Août et le
silence.
Le moment est
enfin venu où les sons tombent d’eux-mêmes au sol.
Elle compte un à
un les oignons déshydratés qui baissent les bras.
Grinçante,
l’oreille, prise de vertige face à l’instabilité des deux guêpes qui dépassent
son front quand elle pose une fesse sur
la marche.
L’os s’y attache.
La chair n’existe
pas.
La chair ne s’est
pas encore amassée.
Elle garde en se
relevant deux marques rouges à l’arrière de chacune de ses cuisses.
Son torse moite
se colle au coton du maillot de corps jauni.
Elle négocie avec
ses sandales de plastique les ampoules dont l’eau jaillit lorsqu’elle les
presse, elle voudrait la boire.
La semelle gauche
est toujours plus creusée que la semelle droite.
Les étés sont
figés sous son adulation.
Ça ne changera
pas.
C’est un corps
qui ne change pas, qui ne changera jamais parce qu’il n’appartient à personne
et ne revendique rien.
C’est un corps
qui n’attend pas.
Il est nerveux et
définitif.
Poussé par la
seule impatience de l’espace.
C’est un corps
sans temps.
Dédié au
privilège de pouvoir rafraîchir vite, presque n’importe quand, ses joues sur la
vitre glacée.
Pédaler vers
rien.
Freiner beaucoup
trop tard.
Pédaler pieds
nus.
Les mains serrées
jusqu’à l’ankylose sur le guidon, la pointe de son auriculaire passe sur le
morceau de caoutchouc déchiré de la
poignée et la douceur de ce contact la fait basculer tout entière dans son
doigt.
Il n’y a pas
d’autre lieu que celui où la pédale écorche la cheville en frôlant le rebord du
trottoir.
Tout ce qui
pourrait s’échapper de ce corps absolument disponible est immédiatement
circonscrit, intégré au rang des créations du grand jeu sans fin.
Du jeu plein
d’étoffes, d’allers et venues de reines démentes et de traîtres.
De traînes
lassées, de caveaux s’ouvrant dans les placards.
De poussière.
Toutes les
poussières.
Ancienne.
Blanche.
Dedans.
Omnivore.
Envahissante.
Dehors.
Aveuglante dans
les derniers jours sans la moindre goutte de pluie.
Volatile et mate.
La poussière
percée, tracée, ouverte, alignée.
Dans laquelle
s’ordonnent les routes qui descendent du Nord au Sud et puis gravissent les
côtes interminables des trajets de fortune.
Des bonnes
fortunes.
Des victoires et
des pouvoirs acquis sans ménagement.
Assise sur le
trône immuable de son règne, la gamine observe.
Le mollet gauche
bloqué par le métal froid de la rampe d’escalier, la sandale bat nerveusement
l’air.
Son orteil crispé
la retient.
Toute parcelle de
la peau découverte doit encaisser.
C’est une
occupation à plein temps.
Ingurgiter, s’imprégner des changements effleurant chaque
zone de contact.
Trait froid de la
céramique sur l’épaule.
Œil plié sous
l’agitation des particules.
Nez coulant des
humeurs transparentes.
Poignet essuyant
les humeurs transparentes.
Polissage des
talons contre la douceur du carrelage.
Piqûre de
moustique sous le menton.
Marque de
l’élastique du slip, inscrite d’une hanche à l’autre.
Essuyer, lisser,
gratter, écorcher, pincer chacun des lieux de la rencontre avec sa peau.
Un corps
magnétique, attirant à lui toutes les fibrilles impalpables sillonnant les
interstices.
Son corps la
dépasse.
Les femmes
l’habillent.
Et puis le
mettent nu.
Elles
sanctionnent les degrés d’usure et de saleté et analysent les prélèvements
qu’elles effectuent sans cesse sur son temps.
Ce sont des
traces inaccessibles à son œil profane que seule leur expertise localise
infailliblement.
La gamine baisse
la tête.
Elle a toujours
trop de quelque chose.
Les femmes lui
ravissent toute excroissance.
Une tâche bleue,
improbable, sur son pullover bleu.
Les femmes sont
très propres.
Elles
assainissent.
Leurs mains se
tordent dans des linges et plongent dans des liquides tout ce qui grouille et prolifère sur la
peau.
Elle les regarde.
Enveloppée par
leur zèle et prise en étau dans la
succession de leurs gestes radicaux.
Les seins des
femmes les dirigent vers le dehors des choses.
Bouées flottant
ignorantes des hauts fonds.
La gamine jette
sur leurs trajets précis mandatés pour
sa désinfection un regard en biais.
C’est un œil
vicieux, saturé de mépris.
De tout le mépris
dont est capable son anatomie désincarnée.
Son torse, à
elle, n’a rien à éduquer, rien à encadrer.
Il est ouvert,
vaste et sans limite, à tous les soubresauts, les percussions, les convulsions
sifflantes.
Á toutes les
touffeurs, les brusques courants glacés.
La mousse amère
du savon à la surface de l’eau du bain encercle ses aisselles et les muscles
creux de ses pectoraux enregistrent, à la seconde près, l’évolution des
alliances caloriques.
La gamine
s’ébroue.
Elle secoue la tête
et fait valser les gouttes autour d’elle.
Le moment du bain
s’évase, se dilate et l’eau, en se refroidissant lentement, lui enveloppe la
peau d’algues.
Le savon dilué
lui donne un goût de coquillage.
Il faut aller
regarder de plus prêt.
Ses yeux s’extraient,
assez endommagés, de la mixture.
Sa peau,
frictionnée dans tous les sens par ses plongeons, élimée jusqu’à son envers.
Le fond de la
baignoire, aménagé en escalier somptueux descendant aux abysses, garde ses
secrets.
Elle serre ses talons tous ensemble, les presse
contre le bord de la première marche sur
laquelle se pose son postérieur malingre.
Elle se condense,
se regroupe.
Prêt.
Son corps
s’éparpille en glougloutant puis remonte à la surface dans un fracas
assourdissant.
La gamine a tant à
faire.
Elle est attachée
aux analyses minutieuses des denrées.
Á la maîtrise des
écoulements.
Gouttes, rigoles,
jets, l’observation méticuleuse de tous les fluides opérant avec leur
immaîtrisable inconstance.
La gamine
enveloppe parfois dans cette humidité ses deux sœurs.
Dans la baignoire
ou ailleurs, ses droits d’aînesse lui garantissent leur main d’œuvre facilement
impressionnable.
Elle les pousse,
de gré et souvent un peu de force, dans les soutes de ses navires.
Elle les noie
aussi, régulièrement.
Puis dans un de
ses élans oblatifs coutumiers, in extremis, finit toujours par les sauver.
Elles
n’ont pas à discuter, à s’organiser, la gamine est là et décide de tout.
Le fruit de ses
réflexions les emmène accomplir le miracle des histoires sans dénouement.
Elles n’ont rien
à craindre, il faut qu’elle les initie à ses jeux. Qu’elles sachent une fois
pour toutes où les mèneront leurs pas lorsque les femelles auront fermé la
porte de toutes les salles d’eau et les
laisseront seules sous sa juridiction.
La
baignoire ne doit pas leur faire peur.
Elle
n’est pas tout à fait pleine.
Et leurs têtes,
maintenues sous l’eau pendant quelques secondes, sortent de ses manipulations cyanosées et
vaincues.
Lorsque les échos
de leur panique risquent de traverser les cloisons, compromettant ses
expérimentations, la gamine les réanime
immédiatement.
Qu’elles la
comprennent tout à fait.
Il faut que leurs
larmes cessent.
Qu’elles se
rendent enfin solidaires.
Afin que ses
injonctions se fassent plus claires, elle repose sa main de fer sur le sommet
de leurs crânes et appuie de toute sa détermination sur leur vide existentiel.
Que leur bruit
s’arrête enfin !
Qu’elles
contribuent à leur formation !
Il faut qu’elle
les prépare.
La gamine sent
tout à coup des ailes pousser de chaque côté de ses deux hémisphères également
malveillants.
Il ne lui reste
plus que quelques ordres à leur donner pour qu’elles se déploient largement.
Dès que les
portes, toutes les portes se ferment sur cette marmaille, elle tente, avec
autant de désespoir que de détermination de la mener vers son salut.
Leur assénant à
grand coup de distorsions corporelles les règles qu’elle élabore et applique à
longueur de journées.
C’était pourtant
clair, elle faisait tout le travail à leur place.
Sans jamais
recevoir de leur part aucun remerciement, elle leur ouvre en grand des prés
desséchés pleins de buissons sauvages et
de bêtes ridiculement petites, des souterrains habités de mers presque vierges,
des lacs, des forts intouchables.
Elle leur propose
tout ce qui au monde peut bouger, ramper, courir, sauter, reculer sans tout à
fait disparaitre.
Tout cela dans
l’élan de sa générosité sous-estimée.
Car elle n’attend
presque rien en échange.
Le seul respect
de quelques-uns de ses principes.
Et leur
participation aussi attentive que possible à son champ d’hypothèse.
C’est promis,
elle les laisserait traîner au beau milieu de ses cultures de perles et
d’immondices.
Point n’est
besoin qu’elles sachent trier, c’était sa mission, son sacerdoce.
Bien sûr, bien
sûr, ses plans d’organisation tournent parfois court.
Lorsque leurs
doléances changent de destinataire et que les deux mijaurées, ses associées
profanes, courent en sanglots en référer aux instances.
Noyade, noyade,
noyade.
Que de mots vains
sur ces manœuvres initiatiques.
La gamine veut
leur apprendre comment vivre au clair, s’évader enfin de l’eau saumâtre de la
génétique.
Les divers
projets dont elle teste la pertinence sur ses sœurs partagent un seul but,
résister.
Résister !
Les aguerrir, les
préparer pendant qu’il est encore temps aux infectes confrontations à venir
dont elle, elle seule, connait toute la teneur maligne.
Elle prévient.
Elle se doit
d’accepter que sa tactique offre quelques failles.
Souvent des
doigts se pointent, des yeux écarquillent
leurs pupilles, des voix s’affûtent, avec une telle rancœur qu’elle en
reste toute chose.
La gamine est
brusquement prise de doute, acculée à la résignation.
Elle se sent
devenir perplexe face à la démesure de sa condamnation.
Elle baisse le
front.
Elle baisse les
bras.
Dans l’isolement
de l’expiation, sa foi est secouée.
Elle s’en
inquiète à juste titre, devra-t-elle donner toute sa vie pour les autres ?
Du fond de sa
réclusion, la gamine soupire de toute son âme, entendant leurs rires, ses sœurs
innocentes revenues sans sourciller à l’abrutissement de la dînette.
Comme elle les
plaint !
Comme elle maudit
leur aveuglement !
La légèreté de
leur enfance, écrasée sans même le savoir dans l’étau des injonctions.
Leur vacuité
légitime comprimée en pleine insouciance entre les couches épaisses des mises
aux normes effectuées pour leur bien.
Elle y songe.
Elle se concentre
et consacre à leur initiation suivante l’élaboration de nouvelles manœuvres.
Elle leur dira.
Une fois de plus.
Tout est au sol.
Tout se penche
vers lui indéfiniment.
Et il semble à la
gamine que, juste au-dessus, quelque chose bouge.
Les femmes
ondulent, virent et voltent au-dessus de son domaine.
Au passage, elles
la convoquent et la forcent au repos pour pouvoir la rassasier.
Mais malgré la contention, la gamine reste employée.
Mais malgré la contention, la gamine reste employée.
Ses doigts
grattent, tapotent.
Sa bouche lui
impose des épreuves.
Les goûts ne se
délivrent pas à la légère.
La gamine a
peaufiné les succulences.
Profiter, profiter.
S’incorporer
toutes les consistances.
Les fondantes,
les juteuses, les croquantes.
Mâcher, déglutir.
Lécher et sucer.
Les fadeurs, son
palais, les acides, ses sinus, les amertumes, sa bouche.
Où est le
commencement ?
Elle travaille continûment
à la perception des échanges.
Des dispositions
dont il faut retracer les contours aux moments des mises en commun familiales.
Elle s’absente
alors quelques minutes de l’activité épuisante de ses sens pour se présenter,
le mieux pliée possible, à la compression des commentaires.
La gamine doit
alors s’effacer presque totalement.
Ouvrir la bouche.
Pour la remplir.
Fermer la bouche
Pour bien se
taire.
Hésiter à se
servir une seconde fois.
De la purée.
De la parole.
Hésiter, chercher
tout de même sa place, dans ces remous de bras et de ventres, cette submersion
de glandes traversant la table, distribuant à toute volée la pitance et les
injonctions.
Elle sent qui la
frôlent ces seins toujours tendus, toujours actifs sous l’effort et l’urgence
de la maisonnée entière à faire passer par le ravitaillement.
La gamine
concentre son attention, oscillant sur son coccyx.
Tentant
d’identifier les trajectoires qui traversent la salle.
De faire bonne
figure dans cette course de chair et de mots sérieux accrochés au revers des
actes.
La gamine cale
son poitrail informe contre le bord de la table.
Á chaque fois,
malgré tous ses efforts, leurs langages lui restent impraticables.
Elle cherche les
mots qui éveilleraient leur intérêt.
Les mots des
grandes affaires.
Tente de prendre
part aux débats qui se croisent au-dessus de sa tête.
Ses à-propos se
perdent.
Ils tombent, à
plat, inévitablement.
Elle n’a pas pris
toutes les mesures, les préséances l’égarent un peu.
Il lui est
fortement conseillé de grandir.
C’est ce qu’elle
tente, coincée sous leur juridiction,
donnant de sa voix aigüe son
point de vue sur la marche des affaires.
Elle n’a pas à
s’en mêler.
Elle risque une
remarque à la volée.
Elle n’a pas
l’âge.
C’est une pente
où la gamine s’aventure parfois par complaisance mais où elle se perd.
Les conversations
ont des bords huilés contre lesquels elle dérape.
Remise à sa
place, où elle cesse de s’agiter.
Mais où
étaient-elles ?
Où étaient-elles
donc lorsque le temps n’existait pas ?
L’essentiel lui
échappe.
La gamine sait
comment le retrouver.
Elle mange vite.
Elle demande à
sortir de table.
Pour aller dehors
et inspirer.
L’air est
toujours là.
Il effleure les
mêmes parties nues, le haut des chaussettes, arrondit sa main sur les genoux et
la serre un peu plus autour de chacune de ses cuisses.
L’air est
traversé par les jambes sans répit de la gamine.
Ses jambes
noueuses l’accompagnent partout.
Elles l’élèvent
et la plient, la tordent et la soulèvent.
Elles sont aux
prises avec des labeurs divers, tous primordiaux,
où chacune des
jambes détourne à sa façon le cours de ce qui se décide ailleurs.
Même lorsque
l’horloge des nerfs épuisés sonne un répit, elles continuent de sautiller,
gigoter, cloche-pied.
Les femmes
basculent leurs hanches, elles ne sautent plus.
Leurs
arrière-trains oscillent dans des buts exclusivement pragmatiques.
Elles vont
toujours quelque part.
Les femmes
suivent leur chemin, précédées du matin au soir par l’objectif prochain.
Comment leur
accorder la moindre confiance lorsque chacun de leur pas déchire l’alliance si
fragile des forces invisibles et laisse
sur la blessure les seules médications de l’eau chlorée et de la graisse
chaude.
Les femmes de la
maison n’ont pas l’intelligence de leurs pieds ni de ce qui les supporte.
Ils sont assidus,
présents au déplacement mais sans discernement.
Leurs pieds ne
marchent pas.
Ils atteignent
les uns après les autres des points en traversant du vide.
Leurs jambes portent des charges telles qu’elles sont
incapables de poursuivre l’éphémère.
Bien sûr, leur
corps peine à les suivre.
Alourdi par la
fonction invalidante de se mener d’un lieu à l’autre.
Comment
survivre ?
La gamine tourne
la tête puis le tronc.
Elle tourne.
De plus en plus
vite.
Jusqu’à ce que le
paysage entier défile à l’envers sous ses paupières fermées.
Puis elle ouvre
les yeux et laisse un à un tomber ses membres sur le sol.
Dans
l’effondrement les couleurs accompagnent sa chute.
Les femmes
ouvrent leurs bouches et se rassemblent.
Elles l’entourent
et lui crient d’arrêter.
C’est simple.
Mais elles ne
comprennent pas les enjeux.
Elles ont donc
oublié.
Ou bien elles
n’ont jamais été des filles.
La gamine
s’étourdit ainsi pour conjuguer.
Conjuguer est sa
passion suprême.
Les images qui se
brouillent et les pensées qui sombrent dans
les dissolutions.
La légère nausée.
C’est une réponse
donnée sans ambiguïté par son abdomen.
La gamine
communique.
Les viscères.
Le plancher.
Le souffle
dedans.
Les rafales
dehors.
Les parcelles
toujours entrouvertes de ses cerveaux.
Les femmes ne se
penchent plus sur l’inconnu.
Tout est devenu
simple.
Il est possible
qu’elles ne se souviennent pas.
Possible que les
forces se soient déplacées à leur insu.
Elles ne se
souviennent de rien.
Et maintenant
qu’elles ont tout oublié, les femmes sont scellées à l’utile.
Leurs corps
massifs se sont interrompus là, fixés à l’attention portée à tant objets
distincts.
Elles promènent
leurs ossatures, enveloppées des biens qu’elles possèdent et entretiennent sans
fin, dans une spirale où s’enchaînent l’ordre visible et leurs ordres.
Des biens si
pesants, condamnés à l’inertie de leur fonction exacte.
Des biens si
pesants.
Pour s’assoir, se
coucher, se laver, se vider, se remplir.
Des objets à
profusion, les conviant sans cesse à l’usage.
Des choses à ne
plus penser.
Des choses qui
pensent à leur place.
Organisent
inlassablement les minutes qui leur sont dues, jour après jour, dans un temps bouclé
où même respirer est superflu.
Lui faudra-t-il
aussi oublier ?
Il faudra oublier
tout.
C’est impossible.
La gamine qui les
observe nuit et jour se réduire à un emploi du temps et le glisser sous le
mouchoir de leur boîte crânienne s’oppose.
Un mutisme
compact qui recouvre le bruit des appareils que les femmes manipulent.
La gamine veut
perforer l’ordre.
Elle veut
continuer à le démembrer, à le reconstruire.
Elle s’opposera.
Elle s’allonge
dans le noir et apprécie la distance qui la sépare des besognes.
C’est leur
mémoire qui pend le long de leurs journées.
En berne leurs
tissus, plus jamais flottant dans les grands larges.
La gamine ferme
les yeux et se sent devenir toute raide, aspirée par l’étroitesse de ce destin
à tout faire.
Elle ne veut pas s’attacher
aux choses uniquement pour les changer de place.
Elle ne veut pas
intervenir dans ce qui s’effectue au-delà d’elle, dans l’arrière-plan courbe.
Elle ne veut
toucher le fond de rien, ne se poser sur rien.
Elle veut le
mouvement, rien que le mouvement.
Elle s’endort en
construisant chaque soir dans les orifices de sa mémoire les places fortes où
elle maintient son droit à ne rien oublier.
Quoiqu’il lui
advienne.
La gamine n’en
sait rien, son corps sait pour elle.
Il désobéit à
tout.
Il se contracte
et s’organise contre elles.
Jeter un caillou
dans la fenêtre derrière laquelle les femmes se décomposent.
La gamine
regarde.
Elle sent un
poing fermé au centre de son absence de sein.
Puis elle tourne
le dos à la cuisine et part.
Elle s’enfonce
dans le territoire sans limite de son enfance incurable.
Dans son agenda
si fourni, tant d’affaires sont à mener qu’elle a décidément négligées beaucoup
trop longtemps.
Elle n’avance pas
dans le même temps que les femmes autour.
Leur temps est un
temps soumis, ouvrant à tous les vents ses secrets dévoilés, libérant à chacun
de ses passages une odeur mêlée de désinfectant et de moisissure.
Elles la hissent,
la tiennent fermement dans le sens imposé de la marche.
C’est,
inévitablement, une marche en avant.
La gamine lève le
menton, tentant d’apercevoir au loin les contours d’une porte ouverte, ou une
sorte de porche.
Mais leurs mains
lui courbent la nuque et la maintiennent face aux tâches.
Á accomplir, à
recommencer, à accomplir, à recommencer.
Sans retour
possible, sans écart, sans autre chose à faire que faire.
Et nul porche,
nulle porte à atteindre.
La seule
répétition sans fin des gestes.
Elle se débat.
Profite d’un
moment d’inattention pour glisser souplement et sans bruit le long des flans
épais de cet animal qu’elle deviendra, abattu, pétri d’ennui et sans
métamorphose.
Elle se laisse
glisser et leur échappe.
Pour quelques
temps encore, pour quelques temps encore.
Elle fait
volte-face et court se réfugier à l’envers.
La gamine ne peut
aller et venir que dans un temps extensible, s’étirant puis se condensant en un
éclat minuscule.
La gamine doit
aller et venir.
Faire marche
arrière puis repartir, monter en descendant et éviter à tout prix les lignes
horizontales des saisons sans issue.
Elle sait bien
pourtant.
Elle le mesure à
chaque équinoxe.
Elle sent ce
temps des limites l’annexer progressivement.
C’est une
occupation sourde du territoire qui la rythme sans à-coup.
Mais elle peut
mesurer, au hasard, elle se réveille un jour et en se levant, c’est le matin.
La gamine sent
fuir hors de sa cage thoracique le pouvoir de transformer les choses, de se
transformer en chose.
Elle sent depuis
peu qu’elle se déplace plus souvent entre les choses lorsqu’on lui en donne
l’ordre.
Leurs ordres,
susurrés, criés, ordres articulés avec application, cachant leur unique
commandement.
Grandir, il faut
grandir, grandir, grandir.
Elle s’oppose à
leur dictat.
Elle tente de les
effacer en s’effaçant elle-même, se réfugiant partout, devenant discrète
jusqu’à la transparence.
La gamine
s’absente et croit qu’on l’oubliera.
Mais c’est fait,
elle ne leur échappera pas.
Elle grandira
plus qu’il n’est possible.
Observant un à un
les effets dévastateurs de cette croissance sur toutes ses agilités.
La gamine croît
vers les masses.
La gamine prend
du poids, d’heure en heure.
Elle prend de la
taille.
Elle n’y coupera
pas.
Elle ne veut pas
que son sort soit jeté aux devoirs que les femmes accomplissent à longueur de
journée.
Elles
l’entourent, l’encerclent, bousculent son avenir de leur impatience et de leur
volonté tenace.
Elles veulent que
la gamine soit.
La gamine doit
les suivre.
Elle doit les
suivre.
Les femelles
piétinent, leur œil scrute le moindre signe augurant le bouleversement tant
attendu.
Il faut grandir,
il faut devenir le plus vite possible.
Mais la gamine ne
veut pas.
Pour rien au
monde.
Elle essaie.
Pas de ces
mamelles-là, qu’elles aillent vers quelqu’un d’autre.
Elle les offrira
à qui les veut.
Elle essaie.
Elle pose ses
mains bien à plat sur l’emplacement de ses seins à venir et appuie de toutes
ses forces.
Pour qu’ils
passent, qu’ils disparaissent.
Elle essaie.
Elle creuse une
crypte au fond de sa cage thoracique et y ensevelit sa paire de seins á venir.
Qu’ils restent
enfouis dans le noir.
Elle veut
continuer à marcher sur le fil des jours sans but, des nuits simplement, qui
passent et s’achèvent.
Elle ne souhaite
pas régenter un jour les rangements.
Elle ne veut
devant elle que des fils.
Elle ne veut que
des fils entre elle et les choses.
Rien qui puisse
la dévier de la tâche imposante de leur demeurer, partout et toujours, ouverte
et disponible.
La gamine a tant
appris.
Elles insistent.
Elles veulent
qu’elle les rejoigne, le plus vite possible.
Qu’elle s’extrait
des ombres pour se hisser à leurs côtés jusqu’à la clarté uniforme des
certitudes.
Mais la gamine
résiste.
Elle sait où ne
pas s’en aller.
Elle sait que,
nulle part, ce que ces femmes-là perçoivent et touchent ne reste là où elles
ont cru l’avoir placé.
Elle sait que
tout s’échappe sans cesse, que les contours tapissés de leur ordonnancement se
désagrègent à leur insu et réintègrent en s’y dispersant la frénésie des
nébuleuses.
La gamine
s’assoit, jambes repliées, ouvertes prêtes à l’envol, sous la table de la salle
à manger.
Elle se tait et écoute.
Ses mains
enserrent ses chevilles, elle se prépare.
C’est un abri
relativement sûr, d’où elle peut observer les passages incessants des fées du
logis.
Pratiquant
l’inactivité d’une façon soutenue, la gamine
suit des yeux le déplacement de
leurs mollets et tente à chacun de ses séjours souterrains d’affermir ses
capacités au départ.
Elle s’éloigne
insensiblement de leurs ébats.
Le corps de son
esprit, incorrigiblement happé, est déjà emporté au gré des courants qui
traversent mollement la pièce de part en part.
Elle serre ses
chevilles un peu plus fort pour éviter le plafond.
La gamine
maîtrise tout.
Les
circonférences. Les cercles. Les globes. Les bulles. Les billes. Les sphères.
Les planètes. Les anneaux. Les bagues. Les ronds-points. Les points. Les ronds.
Les gouttes.
Tout tourne.
Tout tourne.
Au-dessus de sa
tête, tout se croise dans un éternel mouvement circulaire.
La gamine attend
autre chose.
Mais ce n’est pas
envisageable.
Elle regarde de
temps à autre devant elle et que voit-elle ?
Que voit-elle ?
La croisée des
deux lignes.
Un angle qu’elle
ne sait pas comment arrondir.
Ce virage qu’il
lui faudra négocier avec la flamboyante poussée des hormones.
Les cellules. Les
globules rouges. Blancs.
L’odeur des
sécrétions profondes.
Les pellicules
sur le dos des vêtements d’homme attachés aux patères.
La valse.
La tête lui
tourne.
Elle hésite.
La gamine trace
dans l’urgence un trait dans le sable humide et froid.
Elle évacue de sa
ligne de conduite petits cailloux et grains.
Elle part d’un
point, le relie à la succession des points.
Elle ne veut pas
voir la fin.
La gamine ne veut
pas pousser.
Elle ne veut pas
se pousser.
Elle ne veut pas
que ses seins la poussent.
Les nuits se
passent.
Le temps se
passe.
La gamine
s’enfonce dans son lit de toutes ses forces pour fermer le temps.
Et elle cherche.
Elle ne veut pas.
Elle ne veut pas.
Être finie.
Elle ne veut pas
que ça lui arrive, elle veut rester droite.
Plate.
Chaque nuit,
lorsque les femmes de la maison se sont enfin libérée de leur consistance et
dorment en fermant les poings sur le lendemain, la gamine tourne et retourne
dans ses draps afin de pouvoir s’apporter une solution.
Elle n’en a
aucune.
Alors elle
s’accroche et attend, en fermant les yeux, que quelque chose se passe.
Qui passerait et
la prenant à bras le corps, l’entrainerait à rebours, vers les terres qu’elle
connaît mieux, vers les terres qu’elle adore et qui semblent, depuis quelques
temps, quelques semaines, se dérober sous ses pas.
Ses terres se
décomposent.
Partent en
miettes.
Alors comme elle
le sent, comme elle le sait, elle tourne et retourne dans son lit pendant que
les femelles récupèrent sous le dais de leurs devoirs à venir.
Elle tourne et
elle pense.
Elle pense
intensément agrippant à pleines mains les rebords froids de son lit.
Elle pense, avec
toute sa joue.
S’effaçant dans
l’indifférente présence de l’oreiller, jusqu’à ce qu’elle le rallie à sa cause.
Quand enfin il
lui murmure que demain, ça ne compte pas, elle chute avec lui dans le sommeil
de grande envergure.
Inscription à :
Commentaires (Atom)