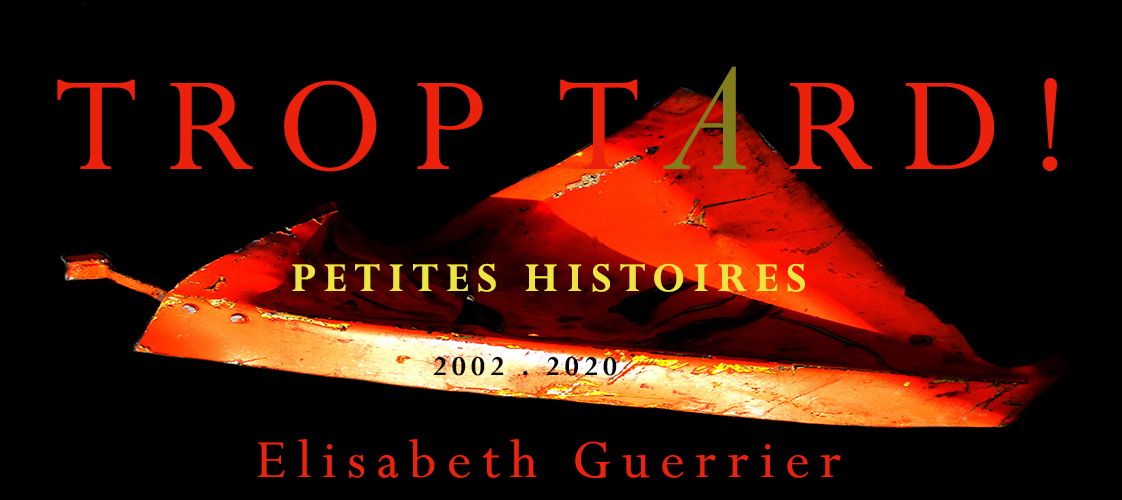En
tendant ses jambes l’une après l’autre, il heurta le manche de la casserole.
Le
réveil surgissait chaque jour, vers quatre heures, quatre heures trente et
envahissait brutalement son corps tout entier.
Il
s’extrayait du sommeil en une seule secousse.
Et
puis enchaînait les actions dans un ordre invariable, des mouvements
parfaitement adaptés, ajustés aux flancs du bateau.
Il
avait consacré depuis quelques mois tout de sa vie au sommeil puis à la
succession méticuleuse des gestes dans la coque exiguë.
Il
leur avait abandonné son pouvoir.
Il
avait, à cette époque de sa vie, bien autre chose à penser.
Bien
autre chose à penser...
Il
tâtonna au pied de sa couchette, dans l’obscurité sa main trouva la prise de la
lampe de chantier et la brancha.
Quand
la lumière se fit brutalement sur le lieu auquel il s’était confié corps et
âme, tout son organisme se remit au travail.
Son
esprit suivait son corps, légèrement en retrait, il ne pouvait pas lui demander autre chose.
C’était
impossible, il avait bien autre chose à penser.
Son
corps portait maintenant seul le poids de leur survie commune.
Il
l’organisait, la scandait, régulait et classait dans l’espace confiné et
l’odeur pesante une série d’actions parfaitement ritualisées.
Et
seuls cet espace confiné et, à l’intérieur, cette série de gestes immuablement
limités aux contingences pouvaient, c’était absolument certain, lui faire du
bien.
Immobilisé
le long du quai, bien à sa place dans le port de plaisance, seul son bateau lui
faisait du bien.
Ses
bords si rapprochés, contre lesquels parfois il heurtait malgré son expérience
le haut de son crâne ou ses genoux, l’encadraient.
Son
bateau l’enveloppait, il donnait à son corps ses limites et c’est exactement de
cela dont il avait besoin en ce moment.
Depuis
presque une semaine, la borne qui alimentait le chauffage électrique avait sauté
et la nuit la température chutait à l’extérieur comme à l’intérieur.
Une
chute affreuse, l’air gelait dehors, gelait presque dedans et il s’affrontait à
la violence des éléments en serrant les dents.
La
mâchoire contractée, il mastiquait le degré zéro.
Pas
de hasard.
C’est
là, c’était bien là qu’il en était, au degré zéro de sa vie, glacée depuis
quelques temps.
Il
s’était enfoui sous le frimas, il avait commencé une hibernation physique et
mentale.
Simultanément.
Il
se maintenait à la température de survie nécessaire, privé du peu de confort que
lui offraient ses appareils maintenant défectueux.
Du
fond de son engourdissement, il l’admettait.
Il
était, lui aussi, très défectueux.
Plus
rien ne fonctionnait.
Plus
rien ne fonctionnait.
Il
avait donc fait le choix de s’appuyer sur son corps en lui confiant la tâche
d’accomplir pour eux deux le strict nécessaire.
Simplement
leur survie, ça suffirait.
Jusqu’à
ce que quelque chose se produise.
Et
lui attendait immobile, accroupi dans le froid qui régnait à l’extérieur comme
à l’intérieur de son corps entier.
Il
était malgré lui tenu de mener à bien un apprentissage.
Celui
de l’incompressibilité du temps.
Pour
la première fois de son existence, c’était plus fort que lui.
Il
devait s’incliner, se plier à un mouvement sur lequel rien n’avait d’effet.
Ni
l’impatience, ni le dégoût.
Depuis
plusieurs semaines, seules les semaines avaient encore de la matière.
Et
lui était devenu cette matière même.
Cet
état absolument nouveau, il avait essayé de l’identifier, de lui chercher, dans
le tissu épais de ses expériences antérieures une trame, un bord.
Il
aurait pu penser à de l’attente.
Mais
non.
Parce
que ce qu’il y avait au bout de ce temps, ce n’était rien.
Rien
ne devait plus se produire.
Et
c’est cela qu’il attendait.
Ce
sur quoi il avait à condenser ses forces se logerait sans doute beaucoup plus
tard dans une sorte de creux.
Mais
là, non.
Tout
débordait encore, suintait, coulait de partout hors de lui.
Il
s’écoutait fuir.
Tout
glougloutait, bouillonnants, amers liquides.
Alors
il s’écoutait.
Guettant
le moindre signe d’un changement d’état.
Il
surveillait le débit des liquides qui accompagnaient sa fusion.
Une
hémorragie constante dont il ne pouvait que constater le ruissellement.
Il
attendait que cela sèche.
Que
le flux des heures recommence, un peu, à l’endiguer.
Cette
vigilance constante, la concentration massive sur cet état totalement inconnu
l’occupait à plein temps.
Lui
sidérait l’âme.
Il
sombrait depuis quelques semaines dans la pâte informe d’une simple succession
de moments.
Il
soupirait sur la lenteur infinie de ce qu’il lui restait encore à vivre jusqu’à
la prochaine heure.
Il
n’était plus en mesure de faire quoi que ce soit d’autre que de décompter, sans
savoir jusqu’à quand, le temps.
Alors
il s’était délégué.
Il
avait confié à son organisme la responsabilité de les assumer tous les deux.
D’assurer
seul les tâches élémentaires.
Son
corps dormait pour lui.
Mangeait
pour lui.
Marchait
pour lui.
Depuis
le début de l’hiver, dès qu’il s’extrayait de la panse fumante de son petit
navire, son corps marchait pour lui.
Pendant
des heures.
Et
lui allait, venait dans son corps, haut et serré sur les semelles de ses
chaussures.
Haut
et droit.
Porté
par sa stupéfaction.
C’était
le seul point qui demeurait dans son existence.
Le
seul point qui le maintenait dans son existence.
Porté
par de l’ahurissement presque pur, il allait et venait, s’en allait droit devant
lui puis rebroussait chemin.
De
plus en plus loin.
Il
s’arrachait au ventre tempéré de son sommeil, plantait la tête hors de la coque
de son bateau et puis en déchirant la nuit glacée, sortait pour aller quelque
part.
Marcher
lui donnait prise sur ce temps sans consistance, il lui marchait dessus, il
avançait.
Au
moins là, il avançait.
Pendant
les premières minutes de cette marche quotidienne, seuls ses pieds se posaient
sur le sol.
Il
reprenait place en sa vie par les pieds.
Par
la plante de ses pieds.
Le
reste, l’ensemble, ce qui le constituait depuis bien trop longtemps redevenait
transparent pendant la nuit.
L’épaisseur
noire de son sommeil était encore zébrée par les quelques traces blanches
survivant à son ego malade.
Mais
il savait qu’elles aussi seraient bientôt vouées à l’oubli.
C’était
une rude épreuve.
Se
sortir de l’inconsistance.
Se
sortir de la matière inconsistante qu’il était devenu.
Sans
consistance mais beaucoup trop pesante.
Du
poids et du vide, mêlés, sans queue ni tête et qu’il devait chaque matin
envoyer en l’air, bien loin, au-delà de sa conscience pour envoyer ensuite sa conscience
encore plus loin, là-bas, dans les nuées d’un avenir complètement imperceptible.
C’était
une rude affaire.
Et
donc, chaque matin, il entreprenait une nouvelle matérialisation par le bas.
Ses
pieds lui ouvraient l’espace.
Ses
pieds le rendaient en partie à la vie qui l’envahissait pendant la nuit.
Une
vie biologique exclusivement.
Fade
et muette.
La
seule forme de sa vie qui lui restait depuis, maintenant depuis,
depuis
qu’il avait.
Bref,
passons, passons vite, repassons vite, marchons et effaçons.
À
travers chacun de ses pas, auquel il attachait son existence entière, il
sentait qu’il éliminait par le sol certaines choses.
Certaines
actions,
Certains
verbes.
Marcher
avait pris la place de certains autres verbes d’action :
Mesurer,
réfléchir, évaluer, envisager,
Comprendre.
Regretter.
Souffrir,
Beaucoup
Y
penser, y penser sans arrêt.
Ses
pas s’enchaînaient et enchaînaient à eux des affaires incontrôlables.
En
marchant, il coinçait solidement sous ses semelles des sensations informes.
Oublier,
s’échapper, supprimer, écraser, effacer.
Se
vider.
Ce
qu’il portait sur l’axe vertical de ses os, du sommet de son crâne à la plante
de ses pieds avait la résistance et la force sans nuance d’un pilon.
En
marchant, sa colonne vertébrale anticipait, comprimait au sol le moindre
frémissement, tentait d’aplatir les sursauts si désagréables de l’imprévu.
Ainsi
il marchait, marchait chaque jour, pendant des heures.
Du
noir profond, adipeux de la nuit encore pleine à la fin de la matinée.
Il
marchait et asservissait toute sa mémoire sous le joug dévitalisé de ses talons.
Non,
il n’attendait pas.
Il
s’interdisait d’attendre.
Il
ne fallait plus que ça bouge.
Il
ne fallait plus que ça aille.
Que
ça vienne, que ça passe.
Il
fallait que reste figé sous ses pas le temps d’avant, qui pourtant continuait de s’imposer en l’éloignant
de lui et dont il ne savait que faire.
Immobiles,
les soubresauts de ce qu’il sentait encore tressaillir, de loin en loin, dans
le fond tapissé de cuir et de petits cailloux de son estomac.
La
lumière blanche sortit brutalement de l’ombre indulgente la substance du
désordre tout autour.
Autour
de lui, tout répondait sans faillir à son vibrant appel.
Une
harmonie du dégât.
Le
chœur des dévastations.
Tout,
absolument tout, avait sauté hors du cadre.
Tout
avait basculé, s’était enfoncé, avait coulé.
Il
se regardait à travers l’œil las de son décor fumant.
L’effort
de ranger lui était impossible.
Il
ne survivrait pas à l’effet de l’effort.
Á quoi bon ?
Il
n’avait jamais compris l’intérêt de ses nombreux congénères pour la place, pour
les places.
La
première place, oui.
La
première place, il comprenait.
Mais
toutes les autres et les objets qui vont avec ?
Gagner,
oui.
Écraser une à une toutes les
velléités d’ordonnancement où il ne serait pas en tête.
S’extraire du lot des victoires
approximatives.
Mais
c’était foutu.
De
l’extrême pointe de ses deux poumons, il réussit à s’extraire du lot étouffant
de son destin et soupira.
C’était
foutu.
Il
n’aurait plus aucun triomphe à faire valoir.
Aucun
podium à escalader à la force de son orgueil démesuré.
Aucun
but fulgurant à atteindre.
Lentement,
il le sentait bien, il regagnait la substance informe des choses, il s’y
enfonçait.
Se
perdait avec elles dans l’abandon et dans l’oubli.
Il
le sentait bien, il s’oubliait à leur côté en les oubliant là où elles étaient.
Ça n’avait plus d’importance.
Ça n’avait, de plus en plus, aucune importance.
Et
ces choses si nombreuses autour de lui, ces choses de l’hygiène, de la
nourriture, du sommeil, de la navigation, de l’habillement, de la lecture
s’effondraient avec lui, lentement, dans le chaos.
Tout
ce désordre avait fini par sécréter sa propre odeur.
L’ensemble
de l’habitacle exhalait une âcreté presque suffocante qui maintenait à elle
seule un restant de stabilité au sein de cette totale décomposition.
Ses
vêtements, son corps lui-même s’en était imprégnés, flottant des heures durant
sur la sombre odeur des négligences.
Mais
ça n’avait pas d’importance.
Ses
narines persistaient à rejeter toute entremise avec le monde.
Il
n’y avait plus personne.
Son
odeur ne gênerait plus jamais personne.
Son
odeur ne le gênait pas, ce qu’il était supposé devoir sentir était ailleurs et
il était bien trop pris, ailleurs.
Il
chercha le briquet au fond de la poche de son jean et alluma le petit réchaud.
Depuis
que le chauffage avait été coupé, il restait dans son duvet jusqu’à la fin du
petit déjeuner, réchauffant son estomac en tout premier lieu.
Il
sentait, geste après geste, le froid invalidant se pousser et ouvrait à moitié
la cloison du cockpit lorsque la dernière goutte était bue et que le couvercle
du bocal de café lyophilisé était fermé.
Les
masses de l’air qui entrait et sortait alors excitaient la peau de son visage.
Excitaient
la peau de ses mains qu’il frottait l’une contre l’autre pour leur redonner un
peu de souplesse.
Et
puis il s’habillait.
Il
était cinq heures.
Á peu près.
Il
était cinq heures, il sortait, la tête
tout d’abord, puis les épaules.
En
perpétuant chaque jour la même mise-bas du répit sur la douleur que seul le
sommeil lui offrait.
Et
son bateau.
Plus
ou moins.
S’il
avait pu parler.
S’il
avait rencontré quelqu’un à qui parler et surtout si les mots ne l’avaient pas
presque totalement déserté, laissant derrière eux un amas difforme, une sorte
de tas.
Il
aurait dit, je suis tendu.
C’était
le seul état qu’il reconnaissait.
Le
seul état qu’il connaissait depuis plusieurs mois.
Depuis
plus longtemps peut-être mais sa mémoire elle aussi était prise, étranglée par
cet état.
Il
était devenu, tout en lui était devenu une tension.
Presque
uniforme, presque lisse.
Chacun
des muscles de son corps s’était recroquevillé, s’étirant à la fois à partir du
haut et à partir du bas, pour se regrouper au centre, en une toute petite
boule.
Une
toute petite boule compacte, dure.
Il
avait pourtant gardé sa taille.
Rapetissé
un peu peut être.
C’était
à peine perceptible mais sa musculature entière s’était pourtant condensée.
Entraînant
dans son effort de contraction chacun des nerfs qui, massés sous l’effort
provoquaient à la surface de sa peau, derrière chacun de ses globes oculaires,
le long de ses gencives comme une brûlure quasiment permanente.
Une
tension.
Et
une brûlure.
Dans
cet escarpement de lui-même, il avait au fil des jours gagné quelques
compétences étranges.
Une
capacité, par exemple, toute neuve, à repérer, d’un seul coup d’œil, le moindre
mouvement, même totalement furtif.
Le
jour, bien sûr, mais, chose plus curieuse,
aussi la nuit.
Son
œil avait au cours de son épreuve, réussi à tailler dans l’épaisseur de
l’obscurité un fil aiguisé comme une lame.
Et,
évidemment, la marche.
Il
avait gagné un talent sans nuance pour la marche.
Son
pas lourd, son pas lourd.
Va
où tes pas de mènent,
Va
où le vent te pousse,
Va
où tes pas te mènent,
Va
où te guident tes pas.
Ses
pas le guidaient.
Pas
à pas.
Le
froid aurait pu l’immobiliser, le figer sur place.
Alors
il l’avait associé au vent, à ses pas, comme un stimulant supplémentaire à la
terrible force de contre-offensive qu’il avait décidé de rassembler pour
Oublier,
D’abord.
Ne
plus jamais se rappeler,
De
rien.
Va
où le vent te pousse.
Un
matin, il y avait quelques semaines, deux ou trois semaines, il s’était arrêté,
très tôt, au bord du canal.
La
nuit était encore pesante et plutôt terne, abattue sur la nature fatiguée.
Le
vent l’avait poussé, ses pas l’avaient mené comme d’habitude vers l’eau du canal
qui faiblement miroitait.
Alors
il s’était approché, le plus près possible du bord.
Ses
mains dans les poches, il avait baissé la tête et appelé.
D’abord
plutôt bas.
Il
avait prononcé son prénom.
Une
fois d’abord.
Puis
une deuxième fois, un peu plus fort et puis quatre, cinq fois.
Jusqu’à
ce que ses viscères sortent en fumant de sa bouche.
Jusqu’à
ce que le visage invoqué dans son appel efface enfin le vent, les pas, le
miroitement, le canal, toutes ces foutaises.
Voir
son visage.
Oh,
voir à nouveau sa belle gueule.
Sa
belle gueule qu’il s’était arrachée, laissant un trou à la base de son crâne.
Un
autre trou au centre de son estomac.
Et
un autre, plus profond et beaucoup plus large, béant entre ses deux jambes.
Ce
matin-là, il l’avait appelée pour la convier à revenir enfin l’aider à
participer au rituel de sa propre mise à mort quotidienne.
À
venir, une fois, juste une fois, l’aider à brûler en sa compagnie ses effigies
qui jalonnaient le trajet, effectué chaque matin, poussé par le vent, guidé par
ses pas. Plantées là.
Il
fallait qu’elle revienne, dans l’obscurité qu’il s’était appropriée comme un
effet personnel, il fallait qu’elle revienne et l’aide à célébrer son
sacrifice.
Seul,
il n’y arriverait pas.
Jusqu’au
bûcher, ils marcheraient encore ensemble.
Elle
marcherait à ses côtés comme elle l’avait fait avant pendant si longtemps et
lui offrirait le support de sa prestance afin qu’il puisse encore une fois
s’élever.
Se
relever sous les flammes de son anéantissement et la réduire en cendre.
Il
avait articulé le plus prudemment possible chacune des syllabes de son prénom
afin de ne pas courir le risque de le sentir s’effriter à nouveau sous la
pression incontrôlée de ses mâchoires.
Il
avait laissé son prénom s’extraire puis se développer dans toute l’ampleur de
son absence, au raz de l’eau.
Juste
devant lui.
Mais
il ne referait plus jamais une pareille chose.
Il
ne la laisserait plus jamais s’échapper ainsi hors de l’enclos impénétrable de
sa bouche.
Parce
que ça avait été pire encore après.
Elle
était sortie, il lui avait laissé de l’espace, elle avait gonflé, gonflé en
s’enfuyant.
Et
là non, ça n’était plus possible.
Ce
volume face à lui, la matérialité de son vide.
Il
était incapable de lui faire face, de ne pas se dissoudre en entier dans tout
cet espace que son absence ouvrait en grand.
Qu’elle
occupait devant le vide de ses yeux qui
piquaient.
Il
avait failli disparaître et il aurait certainement disparu si cet appel
imbécile qu’il lui avait lancé s’était réitéré.
C’était
impossible.
Il
lui fallait reprendre ses enjambées inutiles et marcher pour se trouver
d’autres façons d’être.
Alors
il avait dit une fois encore, c’est fini.
Il
lui avait dit déjà, des dizaines de fois, c’est fini.
Il
lui avait répété, il se l’était répété.
C’est
fini, c’est fini.
Mais
il lui manquait quelque chose et peut être quelque chose d’essentiel.
Il
ignorait ce qui devait finir.
Il
ouvrit la porte de sécurité et serrant la main sur les courroies de son sac à
dos fit quelques pas sous la lumière du réverbère.
Derrière
la haie longeant d’une extrémité à l’autre le port de plaisance, la ville entière
était muette.
Le
cercle lumineux couleur de coquille d’œuf du réverbère entourait le banc vide
et la poubelle à ses côtés.
Il
tourna la tête.
Là,
au sol, tout autour de lui, creusant, cherchant, fouillant avec ardeur, une
colonie entière de rats, au moins une vingtaine, de tailles diverses débusqués
en plein cœur de leur débauche nocturne, se dispersa en quelques secondes, les
queues raidies sous l’effet de la frustration.
Quelques
cris faibles mais nets furent les derniers indices de la présence active de
cette horde ignorée des dormeurs.
Il
sourit.
Il
n’avait jamais jusqu’alors réussi à les surprendre.
Il
savait que la nuit était besogneuse pour eux tous, gavés jusqu’à l’écœurement
par tout ce que le port offrait de victuailles en putréfaction.
Il
avait déjà entrevu quelques ombres mais jamais ils ne s’étaient laissés
coincer, anticipant certainement son arrivée en ayant rapidement associé sa
personne à la suite de bruits en provenance de la coque du bateau.
S’enfuyant
tous bien sûr, juste avant qu’il ne sorte.
Leur
prolifération était impressionnante.
Que
font-ils dans la journée ?
Dorment-ils ?
Restent-ils
aux aguets, observant les allées et venues du peuple auquel ils succéderont dès
la nuit tombée.
Ils
avaient quitté la place.
Ils
avaient tous déserté le cercle jaune autour de la poubelle, regagné dans le
noir de leur existence secrète les trous, les creux où leurs yeux pouvaient
continuer à percer les secrets des conduites humaines.
Tous.
Non.
Pas
tous.
A
gauche de la limite intérieure du cercle éclairé, il en restait un.
Énorme.
Assis.
Les
yeux fixés sur lui.
Totalement
immobile.
Il
le dévisagea et s’immobilisa également.
Ils
restèrent ainsi, face à face, quelques secondes.
Le
pelage épais, nourri par l’hiver et les vestiges abondants de nourriture, strié
par des traces de noirs et de roux.
Il
le trouva beau.
Il
l’était.
Un
mâle somptueux.
Dans
la grande sûreté de lui-même que lui conféraient sa stature, son expérience et
son âge.
Un
rat à point.
Au
point.
Et
qui le savait.
Ils
restèrent donc ainsi quelques secondes face à face, immobiles.
Leurs
yeux croisés, fondus.
Puis
le rat décida de mettre fin à cette entrevue.
Il
se retourna lentement, précédé par les vibrations de ses moustaches démesurées,
laissant derrière lui traîner sa queue magistralement annelée.
Il
le regarda s’en aller, blessé soudain par son indifférence.
Mais
tout ce qui s’éloignait sans lui l’écorchait.
Il
reprit alors lui aussi le chemin de ses occupations.
Se
frottant à l’air comme à une pierre ponce.
Tout
le blessait.
Il
avait décidément fort à faire pour se reprendre.
D’abord
avec l’entretien physique de sa personne.
Puis
avec la marche.
Le
froid donna immédiatement à ses pas un son sec, caractéristique du gel qui
s’était abattu sur la ville et à travers lequel il était devenu capable de
déterminer la température ambiante au dixième de degré prêt.
Ce
matin, il devait faire moins deux.
Il
ouvrit la porte battante des sanitaires, alluma, s’installa face à la glace, et
ouvrit son sac pour en sortir ses accessoires de toilettes et les poser
au-dessus du troisième lavabo.
Le
sien.
Il
y avait depuis toujours, presque toujours, dans sa vie uniquement deux choses
essentielles.
La
force et la faiblesse.
Chaque
évènement, chaque rencontre était à inscrire sur l’échelle tendue entre ces
deux pôles magnétiques.
Depuis
toujours, presque toujours, il était résolument tourné vers l’un de ces deux
pôles.
Il
était un homme fort.
Sans
ambiguïté, sans hésitation et surtout parce qu’il lui semblait que sa vie
entière avait jusque-là consisté, sans qu’il ait même à intervenir, en l’exhibition de cette force.
Aucun
de ses actes n’avait eu à la démontrer.
Il
lui avait depuis toujours, presque toujours, suffi de claquer des doigts.
D’écraser
entre ses phalanges dans un bruit sec toutes les indéterminations.
Il
était fort.
Il
appartenait depuis des générations au clan des vainqueurs, des gagnants, des
élites.
Cela
lui suffisait.
Il
appartenait à un groupe assez restreint d’individus à qui il était impensable
de demander des preuves de leur suprématie.
Sa
qualité propre n’était pas à confondre avec ses propres qualités.
Il
n’avait pas à exhiber ses qualités.
Il
était.
Suprêmement.
Une
fois pour toutes.
Nul
besoin de controverses, de vaines préséances.
Ses
gènes et certainement autre chose lui servaient de caution, le sang qui coulait
dans ses veines depuis des millénaires et qui laissa une petite trace chaude là
où son rasoir dérapa, aussitôt coagulée par le froid qui raidissait et
ralentissait chacun des gestes de son rasage.
Dans
ce bâtiment réservé aux plaisanciers, seul son corps réchauffait l’atmosphère,
embuant tous les miroirs au-dessus des lavabos.
Il
se rasait à la même place chaque matin, se nettoyait méthodiquement les dents,
les doigts crispés sur le manche de la brosse, crachait puis s’essuyait la
bouche et le visage entier.
Chaque
jour, éliminer ces poils gris et noirs était une urgence.
Rien
n’était vraiment plus essentiel, sauf ça.
Il
ne pouvait ouvrir la marche qu’avec ses deux joues lisses et douces.
Ses
joues vierges et les muscles de ses mollets concouraient comme un appui très
sûr à son projet.
Son
grand projet, face au vide qui transperçait son avenir, apparu un soir dans
toute sa flamboyante évidence.
Un
projet de réhabilitation magistral. Qui lui était apparu, telle une révélation,
fugace, essentiel, un soir.
Il
avait, ce soir-là, allongé à plat ventre sur la couchette, pleuré longtemps,
bien trop longtemps.
Pour
dire vrai, il lui avait semblé n’avoir jamais pleuré aussi longtemps sans
interruption.
Il
était sorti tout entier, liquéfié, de lui-même, transformé en eau.
Ruisselant
de partout.
Ses
viscères contractés par l’effort accompagnant en vagues ses lames de fond.
Épuisé,
sa joue était restée un moment collée par cet excès de larmes au skaï bleu de
la banquette sur laquelle il s’était effondré.
Après
la dernière secousse, il avait essuyé ses narines, soufflé brusquement dans son
mouchoir avec un bruit mat et c’était apparu soudain.
Le
seul choix possible pour éviter la dégradation définitive lui avait sauté aux
yeux sous ses paupières gonflées.
Il
devait devenir beau.
Irrésistiblement
beau.
Un
homme de fer, irradiant, magnifique.
Attirant
tous les regards autour de lui, imposant
dès son apparition de l’admiration muette et de l’envie mêlées.
Absolument
tous les regards.
Il
devait plaire, à tous, à toutes.
Se
regagner, tout entier, en muscles et en charme fou.
Il
essuya du bout de sa manche la glace embuée et scruta son reflet, immobile, ses
deux pupilles dilatées par des quantités de choses.
Des
quantités de perceptions inavouables qui lui coupaient le souffle de temps à
autre mais n’altéraient pas pour autant la surbrillance irisée de ses deux
cristallins vert mousse.
C’était
ainsi, chaque matin vers cinq heures, il se retrouvait seul, face à sa beauté,
gonflant simultanément son torse et son avenir.
Pleinement
imbu de sa personne.
Et
jusque-là, tout allait bien, très bien.
Une
force étonnante, une force massive l’arrachait à sa propre contemplation pour
le jeter en pâture au monde et à toutes les femmes disponibles qui y
proliféraient.
C’était
après, plus tard, dans la matinée, ou dans l’après-midi, le soir aussi, que ça
se gâtait.
Chaque
fois soudainement et sous des formes à chaque fois différentes.
Il
ne pouvait, autant le dire, pas du tout s’y habituer ni développer des
stratégies de contre-offensives.
Venus
il ignorait d’où, les vols de représailles s’abattaient en piquet sur sa
conscience et son amour propre.
Des
attaques lâches, brutales, sans commisération aucune pour lui ni pour son
affliction.
C’était
franchement dégoûtant.
C’était
dévastateur aussi.
Il
s’écrasait.
Pliait
sous l’offense et le mal être.
Il
en aurait vomi parfois.
Il
en avait vomi, une fois.
L’avant-bras
appuyé contre un des arbres qui bordaient l’allée.
Il
avait laissé là tout le petit déjeuner, le dîner.
Tous
les repas qui s’étaient accumulés au fond de son estomac depuis qu’il ne les
partageait plus avec elle.
Il
ne partageait plus rien avec elle.
C’était
ça.
C’était
ça qu’il devait oublier ?
Qu’est-ce
qu’il devait oublier ?
Ses
tensions si sévères, son labeur, sa croissance, tout ce travail quotidien pour
se redresser, se remettre.
Inutiles.
Il
s’effondrait avec minutie, ne laissant à voir que son enveloppe grise,
traversant la nuit encore lourde pour aller n’importe où.
Ça n’avait plus d’importance.
Il
s’en sortait abattu.
Pire,
battu, défaite vivante.
Il
n’avait qu’une seule solution, décompter.
Décompter
les temps de sa rémission.
Compter
leur fréquence et leur durée.
Parce
que depuis ces longues semaines, il avait fini par s’habituer au combat sans
merci qu’étaient devenus ses jours.
Il
avait aussi pris sans presque s’en apercevoir l’habitude de répertorier avec
minutie les moments où ça s’arrêtait.
Il
s’arrêtait alors lui aussi quelques instants, surpris de respirer, surpris de
pouvoir encore respirer.
Il
s’était tellement habitué à cohabiter avec elles que lorsque les diverses formes
de sa souffrance s’interrompaient, il avait soudain très peur.
Peur
de se trouver seul devant un vide béant dont il ne parviendrait jamais à sonder
la profondeur.
C’était
comme un malaise.
Un
vertige, donc il s’asseyait.
Et
il se disait alors, ce vide, ce vide béant dont je sonde la profondeur,
Le
fond de ce vide béant, au fond, c’est ça.
C’est
à ça que je dois m’habituer.
Ma
vie, c’est ça.
Maintenant
c’est ça.
Ma
vie d’avant, ce qu’il en reste, c’est ça.
Un
trou.
Elle
a bien fait de partir.
J’ai
eu raison de la quitter.
J’ai
eu raison de partir.
Elle
n’aurait pas dû me quitter.
Je
la comprends.
Il
la comprenait tant, elle était tant comprise par lui, tant comprise en lui, que
cet éclair un peu mou de sa pensée s’achevait par une migraine d’arrachement
telle qu’elle l’obligeait à rester immobile, allongé et à garder les yeux clos.
Et
le déséquilibre foncier dont seules ses marches forcées le protégeaient l’aspirait
de plus belle.
Il
s’y engouffrait, muet à vie.
Ouvrant
sur ses entrailles en feu ses yeux vert mousse inutiles.
Sa
peau devenait alors une mince affaire, un tout petit rempart contre le doute
total qui venait bousculer jusqu’à sa certitude même d’exister encore.
Ou
d’avoir existé un jour, un seul jour depuis toutes ces années.
Où
elle était encore là.
Il
fallait qu’il l’enterre.
Mais
ce qu’il enterrait là, c’était sa vie de garçon.
La
vie bien dissolue du garçon qu’il était et qui l’avait coulée douce.
Il
l’avait coulée, fait couler dans sa légère inconsistance, son temps sans passé.
Toute
sa vie réduite sous ses pas à une peau de chagrin, la peau de sa voûte
plantaire enflammée.
Pleurant,
pleurant à sa place sur la peau qu’il avait tant aimé lui toucher, sur la peau
qu’il aurait tant aimé lui faire.
Qu’elle
lui avait arrachée en partant, en gardant un pan sur elle.
Il
était dénudé par place et écorché vif sur l’ensemble du corps.
Ses
pieds marchaient encore.
Mais
même eux.
Il
avait perdu pied, ses pieds aussi.
Il
attendait en marchant de passer à côté d’elle, de s’en passer.
Il
faisait des pieds et des mains pour que ça lui passe.
Pour
reprendre possession de tout ce qu’elle avait emmené sans lui demander son
point de vue.
Sans
son avis.
Elle
lui avait tout pris, c’est simple.
C’était
sûr.
C’était
sûr, c’était aussi elle qui avait pris.
Mais
lorsqu’il en arrivait à ce passage-là, immanquablement le flot peu précis de ses
souvenirs tournait vite son cours vers le havre de ses intimes convictions.
Celui
des petites réponses simples qui ne nécessitaient pas de question.
Elle
lui faisait trop mal, il ne pouvait pas penser.
Il
ne pouvait que marcher.
Il
traversait ses pensées en détournant la tête.
Et
lorsque parfois la mémoire soudain lui revenait, par à-coups, qu’il la voyait alors
debout au centre de certains souvenirs, la tête encore penchée sous le poids
des offenses qui l’avaient poussée à s’enfuir, il regardait ailleurs.
Il
devait l’ignorer.
La
laisser passer et puis disparaître.
Il
ne pouvait pas être partout à la fois.
Dans
le désert de la survie.
Dans
le désert de la mémoire.
Dans
le désert des origines de sa perdition.
Du
temps à remonter pour surmonter la violence des coups qu’il prenait à la volée.
Des
coups dont il était à quelques doigts de s’avouer qu’ils étaient mérités.
À
quelques doigts de s’avouer vaincu.
Alors
il changeait de direction.
Et
reprenait sa souffrance en amont, là où il l’avait laissée.
Puis
parfois, tout aussi soudainement il s’entendait se calmer.
Il
appuyait alors légèrement la paume de sa main sur son front où les percussions
s’étaient tues.
Plus
rien ne battait.
Il
se disait ça va mieux.
Il
reprenait ses droits sur son organisme.
Mais
il n’était pas dupe.
C’était
pour un temps.
Un
temps seulement.
Oui,
oui, il savait bien que tout cela était une affaire de temps, exclusivement,
qu’au fond, quels que soient leurs efforts respectifs, ni son corps ni lui
n’avaient à y faire.
Il
n’avait rien à y voir.
Il
ne pouvait rien voir, sentir seulement la raideur dans la nuque qui présidait
sans faillir à la prolifération anarchique de toutes ses contradictions.
Celles
auxquelles il pouvait penser.
Qu’il
réussissait à évacuer en n’y pensant pas.
Celles
qui le traversaient de part en part, lui laissant une déchirure presque
intolérable en bas de l’abdomen, qui le laissaient parfois à haleter, incapable
de plus rien faire d’autre que
d’attendre en s’appuyant de toutes ses forces sur le ventre.
Il
avait la diarrhée depuis deux mois, jour pour jour.
Celles
qui remontaient par bouffées, faisant transpirer son front et ses tempes.
Celles
qui descendaient par saccades dans le creux de son dos.
Tout
cela le lessivait.
L’achevait.
Il
aurait pu s’allonger au sol, s’étendre, terrassé, embouteillé complètement par
ces va-et-vient de contractions qui circulaient à toute vitesse dans chacune
des parcelles de son corps.
Mais
il aurait fallu qu’il s’allonge à ses pieds.
Pour
lui montrer enfin, la face contre terre, qu’elle seule pouvait venir à bout de
l’exode massif des parties de lui-même qui le traversaient de part en part.
Elle
seule pouvait l’envelopper et freiner cette débâcle interne.
Il
aurait pu tendre les bras pour anticiper sa chute.
Mais
c’était impossible.
Il
réalisait, soumis au vertige de tous ses organes qu’elle le canalisait, avant.
Elle
mettait de l’ordre, interrompait les migrations incessantes de toute cette
chair palpitante.
C’est
elle qui avait les deux bras tendus pour le retenir.
C’est
elle qui savait comment l’épargner.
Sa
présence seule lui servait de heurtoir.
Il
butait contre elle.
Il
butait contre elle.
Lorsqu’il
sortait des sanitaires, les joues fraîches et lisses sous le vent, il avait
regagné un peu de son centre de gravité.
Repris
en main le contenu presque liquide qui s’échappait de lui si souvent pendant la
journée.
Le
froid l’aidait peut-être.
Il
pouvait s’opposer à lui, tendre tous ses muscles pour tenter de le repousser.
En
marchant il le fendait, l’éventrait.
Fumant,
crachant contre lui.
Et
de sentir ainsi sa peau lui résister vaillamment lui redonnait un peu la force
de ne penser à rien ou de penser à autre chose.
Au
froid.
Le
froid l’excitait.
Sa
mémoire s’effritait.
Le
froid le tenaillait.
Et
ça lui allait, pour un temps.
De
se sentir serré contre les éléments le réchauffait un peu.
Il
avait froid.
Il
avait tellement froid au dedans que l’effondrement des degrés lui paraissait
dérisoire.
Il
réussissait à s’avancer, à rassembler sa concentration autour des parcelles de
son organisme qui jonchaient le sol de son long périple quotidien.
Il
refaisait inlassablement le même trajet, choquant au passage du pied quelques-uns
des morceaux de son corps qu’il abandonnait sur le bas-côté à chacune de ses
marches.
Il
y en avait un peu partout.
Des
morceaux du corps avec lequel il l’avait touchée.
Et
qu’elle avait touché aussi.
C’est
à ça qu’il ne trouvait pas de solution, pas d’issue.
Cet
organisme sain et tonique, ce bel organisme à la maintenance duquel il consacrait
des soins si attentifs et réguliers, qu’il emmenait chaque matin en plein vent
le dépasser, le tenir bon, le vaincre.
Qui
poussait vaille que vaille hors de lui le froid, la fatigue, l’ennui.
Ce
corps superbe qu’il construisait pas à pas afin de lui survivre.
Qu’il
équipait d’une matière massive, dense pour l’offrir aux convoitises et aux
aléas du marché de sa renaissance amoureuse.
Son
corps de mâle entretenu avec obstination s’effondrait de l’intérieur.
Il
pensait qu’il la quitterait aisément.
Depuis
très longtemps il la quittait aisément.
Dans
l’espace, c’était assez simple.
Mais
à l’intérieur de son corps, il avait lentement découvert que restaient
accrochés des morceaux d’elle.
Elle
avait traversé sa peau, s’était tapie en dedans.
Par
lamelles, par bribes, épaisses parfois, parfois presque transparentes.
Ou
dures.
Des
plaques brillantes dans ses poumons.
Des
morceaux aux bords imprécis tissés de brun acajou tout au long de ses artères.
Elle
s’était installée en lui comme chez elle.
Il
ne maîtrisait plus rien, plus rien de cette gangrène de l’intérieur.
Il
s’était abandonné à elle, absolument sans s’en rendre compte.
Subrepticement
pendant qu’il pensait à autre chose, elle l’avait gagné.
Et
maintenant qu’elle était ailleurs, il peinait tant à se reconnaître.
Maintenant
qu’il se regardait plus attentivement, tordu et défait, il voyait bien, que de
dégâts, que de dégâts elle avait faits.
C’est
cette découverte tellement dérangeante et tellement inattendue qui lui faisait
si mal, toute cette présence impalpable qui irritait chacun de ses nerfs,
chacune de ses cellules.
Tout
cet usage de lui qu’elle avait laissé derrière elle, comme un ultime signe de
son ancien labeur.
Maintenant
que tout leur passé était devenu son présent.
Un
bloc, un monceau, un tas.
Un
amas de choses éparses qu’il traversait de part en part.
Des
choses pointues et tranchantes qui le traversaient de part en part constamment.
Si
vite parfois, si fort qu’il n’avait jamais le temps de les arrêter pour les
identifier.
Il
y avait plusieurs semaines, quatre, cinq, en rentrant comme chaque matin dans
les toilettes, il avait trouvé quelqu’un à ses côtés.
Alors
c’était parti, sorti, en se rasant il
lui avait craché au visage toute cette bile dont il ne savait plus que faire.
Il
avait pris à témoin ce pauvre type qui se mettait du gel dans la paume de la
main pour lisser sa coiffure.
Il
l’avait pris à parti.
Lui
avait demandé de lui dire sans hésiter tout ce qui lui venait à l’esprit.
Il
lui avait donné à partager sa colère absolue.
Qui
le dévastait des pieds à la tête.
Ça se voit ?
Il
lui demandait de répondre.
Est-ce
que ça se voit ?
Toute
cette rage ?
Le
pauvre type s’était interrompu, avait tourné en souriant le visage vers la
source de cette ébullition qui l’interpellait si brutalement.
Il
était prêt à en découdre.
Prêt
à la découdre.
Á arracher d’un coup sec le fil
de leurs jours.
Á
cause d’elle.
Salope !
Salope infinie !
Il voulait lui attraper la nuque,
lui fléchir l’orgueil et l’écraser en mille morceaux sur le rebord du lavabo.
Il avait regardé dans les yeux
son voisin qui baissait la tête.
Et il lui avait tout dit.
Tout.
Mais en le sortant de sa bouche
dans un jet de vapeur, il avait aussi senti que ça n’allait pas.
Alors il avait haussé le ton pour
s’entendre mieux dire à ce brave homme l’histoire d’un autre.
Son histoire à lui ça n’était pas
celle-là, celle qui s’éjectait en tonitruant dans le froid constamment humide
des sanitaires.
Tout
cela était faux.
Totalement
faux.
Mais
à cet instant, il ne savait pas encore complètement qu’il mentait, tout était
si confus, il avait besoin d’aller au plus vite, de présenter ainsi massivement
une vérité, même de pacotille.
L’homme
la bouche ouverte l’avait compris tout à fait.
Alors ils s’étaient quittés bons amis.
Et
depuis il se levait une heure plus tôt pour ne plus jamais le revoir.
Mais
même seul il ne savait plus où ça finissait.
Il
ne se souvenait plus de toutes les raisons, de tous les détails.
Il
ne savait plus qui elle était.
Ce
qui s’était passé.
Où
elle était lorsqu’elle était partie.
Et
si elle était partie.
Ou
lui.
Il
ignorait si un autre homme que lui l’avait trompé.
Il
se trompait lui-même sur tout ce qui la concernait.
Et
plus encore sur ce qui le concernait.
Il
n’était pas à l’aise avec son passé.
Il
le subissait.
C’était
son passé qui le gouvernait.
Lui
se contentait de marcher dessus.
Une
fois remis au point, il endossa son sac et ouvrant la porte s’engouffra dans la
nuit, puis pas à pas encore une fois, il commença à oublier.
Marchant
et attendant que le jour lui vienne dans les yeux.
Un
jour d’hiver, où les bords familiers de ce qu’il croisait devaient percer
d’abord l’enveloppe argent qui les recouvrait.
Il
mettait presque deux kilomètres à s’appuyer sur les contours de ce qu’il
voyait.
Et
alors, ça allait bien mieux.
L’indifférence
absolue des choses le guérissait.
Il
accéléra un peu pour atteindre cette échéance plus rapidement.
Ça n’allait pas.
Ce
matin, les frottements du jour contre les appuis métalliques de l’eau, de la
berge, des canards imbéciles.
Ça n’allait pas.
Il
devait marcher plus vite.
Se
rattraper mieux.
Ses
jambes l’étranglaient.
Il
ne réussissait pas à s’appuyer sur ses alliés habituels.
Tout
foutait le camp.
L’eau,
la berge, les canards imbéciles, ce matin, au petit matin, il s’en foutait.
Il
était resté en arrière.
En-deçà
des ponts qu’il avait dû couper.
Son
histoire marchait loin devant lui.
Son
histoire menait maintenant sa propre existence.
Il
n’en avait plus la maîtrise.
Son
histoire s’était libérée de tous les ordres qu’il aurait pu lui donner.
Elle
était libre de tout ordre, sans commencement, sans fin.
Il
respira encore, racla au fond de sa gorge les traces des hurlements qu’il
aurait pu pousser et avança à fond.
De
toute façon, il ne se souviendrait de rien.
Il
ne voulait pas.
Surtout
il ne pouvait pas se rappeler.
Elle
revenait, elle partait, elle entrait et sortait sans arrêt mais pas lui.
Il
ne se souvenait plus du tout de lui.
C’était
mieux.
Il
pouvait la regretter sans savoir pourquoi.
Son
histoire et lui se balançaient loin au bout de la corde qu’il tenait pour se
hisser hors de son abandon.
Pendant
qu’ils pendaient ainsi, il n’avait pas à les regarder en face.
Ça pesait.
Ça pesait et c’est tout.
Il
haussa les épaules.
Elles
allaient toutes lui revenir.
Tomber,
toutes ensembles, dans les bras de son charme presque céleste.
Il
s’aiguisait.
Il
taillait soigneusement ses flèches dans le bois dur de son cerveau.
Il
lissait et polissait ses harpons qui devraient d’ici peu s’enfoncer au plus
profond de leur chair.
C’était
décidé, il allait substituer à la précise blessure de ce qui l’avait si
radicalement esseulé, les contours vagues et toujours un peu brumeux des grands
nombres.
Il
connaissait son affaire.
Il
savait comment s’y prendre.
Les
femmes étaient, pour ainsi dire, toutes à lui.
Et
lui à personne.
C’est
ainsi qu’il avait tiré son existence jusqu’à elle, de femme en femme.
Se
superposant et se décalquant à l’infini.
Et
puis elle était venue, par un chemin pourtant connu, déjà creusé par toutes les
allées et venues qui l’avaient précédée.
Et
il s’était enfin reposé.
C’est
ça, c’est ça.
Il
s’épuise.
Il
se lève et dès l’aube, il s’épuise.
Il
marche, il mange, il dort.
Il
est tellement las.
Il
dort, il passe.
Tout
l’immole.
Tout
le tue.
C’est
ça.
Elle
était là et ça le reposait de lui.
Elle
le protégeait contre les risques de son extinction.
Il
se sentait si supprimé.
Il
lui fallait des femmes.
Il
fallait qu’elles reprennent le flambeau de son excitation, de sa transe.
Il
avait besoin de croire qu’il avait besoin d’elles.
Elles
allaient réveiller ses cellules exsangues, souffler et éparpiller les cendres
froides qui emplissaient sa bouche et lui condamnaient les yeux.
Il
lui fallait des femmes, il lui en fallait assez pour pouvoir les mettre une à
une au creux des empreintes qu’elle avait laissées partout sur sa peau.
Elle
marchait devant lui.
Ses
jambes remontaient le temps.
Elle
avançait devant lui et ses fesses berçaient ses mains.
Elle
le devançait et plantait l’aiguille de ses talons dans son estomac.
Il
n’avait rien vu, il l’avait tant suivie qu’il en avait presque oublié que
c’était lui qui marchait dans la surface bienfaisante de son ombre.
Il
y marchait les yeux fermés.
Mais
c’était fini.
Il
était seul maintenant, dans le flot de la lumière aveuglante de ce qu’il avait
dû provoquer, seul au milieu de la fournaise de ses affects décapités.
Tout
en lui craquait.
Tout
brûlait.
Tout
en lui était sec.
Et
ce brasier qu’elle lui avait laissé au centre consommait à lui seul une telle
énergie qu’il avait froid sans arrêt.
Il
marchait ce matin.
Murmurant
des mots sans queue ni tête.
Il
marchait sur la tête.
Elle
lui avait arraché sa queue.
Toute
entière, avec les dents, la bouche, avec les mains, avec tout ce qui lui
appartenait.
Et
puis il s’était vidé.
Il
était devenu plat.
Complètement.
Il
longea l’eau jusqu’à la mer.
Il
lui fallait habituellement un peu plus de deux heures et demie pour faire le
trajet.
Mais
si le froid lui donnait l’impression de marcher plus fermement et plus vite, il
avait déjà vérifié, c’était une illusion.
Le
froid le freinait.
Pendant
les deux derniers kilomètres, il sentait chaque fois se dénouer en lui les fils
tendus à craquer depuis le départ.
Souplement,
silencieusement, le jour ras et presque vert sur les mouettes, l’air chargé
s’enfilaient au cœur des cordes avec lesquelles quelques heures plus tôt, il
aurait pu se pendre.
Puis
elles s’enroulaient à ses pieds et la mer lui ouvrait les bras.
Il
oubliait.
Il
franchissait son déchaînement sans s’apercevoir de rien.
Il
l’oubliait par à-coups, constatait une fois qu’elle était revenue l’occuper qu’il
avait pensé à autre chose pendant quelques minutes.
La
vive sollicitude des affaires nautiques le secondait imperturbablement.
Il
glissait sur elle au tournant en général, prenait les devants et entrait les
yeux fermés dans l’acidité bienfaisante des marées.
L’oublier
se perdait quelques minutes dans l’eau.
Toute
la force de concentration qu’il lui abandonnait l’épuisait.
C’était
une tâche complexe et infinie.
C’était
une tâche jamais achevée.
Il
la reprenait à chaque instant là où il l’avait laissée, ça n’avançait pas.
Ça
n’avançait pas.
Le
vide en face, tranché à plat par la ligne d’horizon, le happait et apaisait un
temps sa nausée.
De
l’air !
De
l’air !
Du
vent et de l’eau.
Son
eau de mer et les rouleaux des vagues, l’air, le bruit des intenses activités sous-marines
qui remontaient, presque imperceptiblement à la surface.
Il
l’oubliait.
Elle
dégageait et dégageait en partant le va et vient de l’oxygène et de l’iode
entre la mer et ses poumons.
Les
embruns respiraient et tout cela lui faisait un bien fou.
Il
alla lentement jusqu’à l’extrême bout de la jetée.
Il
était seul.
En
avançant, il contournait les flaques laissées par la marée basse.
Il
grimpa sur le rocher le plus proche de l’eau et s’immobilisa.
Les
mains dans les poches, les joues presque brûlantes du froid du large, il
respira profondément.
Et
soudain, allongée de dos sur la ligne grise de l’horizon, son ventre fermant
l’entrée du port de plaisance du Havre, elle apparut.
A Philippe 2003