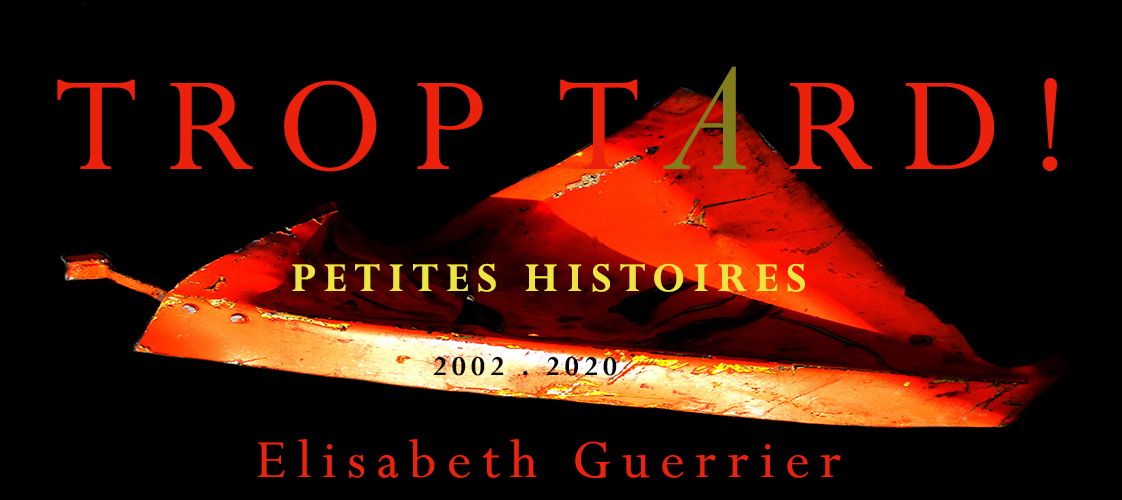Lorsque
la tourmente qui avait dévasté chacune des pièces où elle rangeait ses
illusions s’était calmée, elle avait dû s’asseoir.
Ensuite,
contrairement à toutes ses habitudes, elle n’avait plus bougé.
Elle
resterait là, dos contre le mur, les fesses calées sur le plancher.
Elle
gardait le front posé sur ses genoux.
Faire
l’obscurité.
Puis
relevant la tête, elle scrutait chacun des angles de l’appartement.
Elle
regardait.
Examinait
méticuleusement les traces.
Les
marques laissées par le temps sur les murs.
En
fait tout, dans cet endroit déserté, révélait l’ampleur de la débâcle en
désignant ce qui lui faisait si cruellement défaut.
L’instinct
de sa conservation.
Ça
ne trompait plus.
Le
message s’illustrait de lui-même dans la mise à nu brutale de ce que plus rien
ne venait cacher maintenant.
Un
témoignage accablant qui avait brutalement apporté les preuves du niveau d’aveuglement
où avait sombré son attention.
Des
traces d’érosion partout.
L’usure.
Les
coulures.
Autant
de dépositions accusant sa négligence.
Sans
contestation possible.
L’état
de détérioration de sa vie.
Pas
seulement les défauts de sa vie actuelle.
Ceux
de toutes les autres aussi.
Convoquées
maintenant au parquet de ces pièces presque vides.
Elle
détaillait ses fautes, une à une, en haussant les épaules à la hauteur des lais
jaunis du papier peint.
Sous
chacune des portes qu’elle fermait derrière elle dans l’appartement, elle
entendait les grincements de son esprit coincé qu’elle aurait dû ouvrir.
Beaucoup
plus tôt.
Si
elle avait voulu s’en sortir.
C’était
désagréable.
Ce
qu’elle voyait la consternait tant qu’elle reprenait aussitôt ses tibias à
pleins bras et replongeait dans les ténèbres de ses genoux calleux.
C’était
inutile de s’obstiner à tenter de s’y retrouver.
Après
cette série de bombardements continus, elle reconnaissait à peine l’habitation.
Elle
avait emménagé chez quelqu’un d’autre.
Ici,
il y a quelques mois à peine, elle marchait encore d’un pas alerte, passant
sans y penser d’une pièce à l’autre.
Elle
aurait dû peut-être y penser plus.
Certainement
y penser mieux.
S’apercevoir
à temps qu’elle considérait cet homme comme son prolongement naturel.
Et
qu’elle considérait ces lieux comme le prolongement de cet homme.
Car
depuis qu’il les avait vidés, à chaque fois qu’elle en tentait la traversée, elle
sentait tomber une partie d’elle-même quelque part.
Puis
revenant sur ses pas, elle passait alors des heures à tenter de la retrouver.
Á
essayer maladroitement de se prendre en main, de la tête aux pieds, sans rien
oublier.
Mais
c’était impossible.
Parce
que, depuis qu’il était vraiment parti, dans cette enfilade de couloirs, de chambres,
cet espace s’ouvrant sur lui-même, c’était devenu assez difficile de savoir
s’il était préférable d’aller ou de venir.
De
choisir un lieu où se considérer.
Ce
dont elle avait le plus besoin, la seule chose dont elle ait eu constamment besoin
depuis son départ, ce n’était pas de se promener dans des pièces détachées.
Ce
n’était pas de se donner, pour mieux respirer, des airs détachés.
C’était
qu’il la libère pour de bon et de tout oublier.
Plus
tard, un jour, bientôt, demain dans quelques temps, dans cet endroit abandonné
de lui, sûrement, elle finirait bien par découvrir comment se remettre.
C’était
trop long.
Elle
enfonçait la tête plus profondément encore dans les moufles de ses jambes.
Les
yeux bouchés par ses rotules, elle s’en inquiétait moins.
Elle
était par hasard tombée juste là.
Dans
la salle de séjour.
S’était
aménagée dans cette position pour mieux attendre.
Pour
se consacrer entièrement à l’attente, sans faillir.
Pour
emplir cette attente de tout ce qui restait d’elle.
Lorsque
la nuit tombait, pouvoir effleurer les empreintes un peu râpeuses que le mur
laissait sur ses omoplates.
Pour
être plus sûre d’être bien là.
Ailleurs,
ailleurs dans cette suite de pièces sans début ni fin, c’était devenu beaucoup
trop difficile.
Les
vents contraires la bousculaient, l’ouvraient en deux.
Mieux
valait s’asseoir.
Les
coudes entrés profondément dans la chair malingre des cuisses, elle ressentait moins
les spasmes, toutes ces espèces de torsions, les circonvolutions des douleurs.
Elle
oubliait la sensation d’essoufflement.
La
grande blessure et tous ses tremblements.
Elle
pouvait devenir très paisible.
Elle
pouvait se vider avec application.
Accroupie,
elle essayait de suivre le même chemin que son amour défunt.
Elle
tentait d’évacuer l’espace.
Son
corps entier, lui aussi, faisait le vide.
Cet
homme est sorti.
Elle
écoute attentivement.
Plus
aucun bruit dans l’escalier.
Il
lui a laissé une abondante quantité de silence.
Elle
hésite.
Elle
ne sait pas comment s’en servir.
Il
est sorti de cet endroit où ne se croise maintenant que de l’air.
Elle
pose les poings fermés sur ses paupières et lui parle d’une voix suraiguë qui
rebondit en tous sens dans son intérieur.
Il
est sorti.
Il
est sorti d’ici avec son matériel.
Avec
toute sa vie matérielle.
Il
reste ici pourtant suffisamment de choses utiles pour qu’elle puisse enchaîner
les uns après les autres les gestes de tous les jours.
Suffisamment
de choses pour pouvoir s’attacher.
Pour
ne pas se heurter aux espaces encombrés par le vide qu’il a oublié d’emporter
aussi avec lui.
Lorsqu’il
est sorti.
Il
aurait dû tout prendre.
L’espace
bien sûr.
Et
puis le temps surtout.
Les
heures qu’elle cherche à faire passer entre les quelques objets qu’il a laissés
et contre lesquels elle risque de se heurter à tout moment.
Tous
les moments comptent maintenant.
Les
moments qu’elle passe en les comptant.
C’est
trop long.
Elle
s’allonge, suit le fil du temps.
Ses
os s’allongent.
Elle
entend pousser chacun de ses membres.
Elle
veut le pousser.
Elle
veut le pousser et prendre toute la place qu’il a laissée.
Elle
doit encore le pousser à bout.
Elle
doit l’occuper.
Elle
doit s’occuper.
Elle
doit se consacrer à se tendre.
Pour
écouter.
Tous
les bruits qu’il a faits en s’en allant.
Dont
elle perçoit les ondes abondantes encore sur la surface intérieure de son
front, posé sur ses talons.
Elle
doit se consacrer.
Á réduire pour de bon la surface où elle
s’est étendue à l’attendre.
Á attendre une seule chose.
Absolument.
Que
les contractures qui la paralysent se détendent.
Il
faudrait qu’elle l’assouplisse.
Il
faudrait qu’elle s’assoupisse.
Qu’elle
le laisse vider les lieux et qu’il la laisse dormir.
Il
faudrait qu’elle, toute seule, emplisse ce qu’il a mis à sac.
Le
sac vide, grand ouvert, de toute la vie passée à ses côtés, qu’il n’a pas pris
le temps de refermer en s’en allant.
Ces
années, autrement dit.
Et
cette érosion aussi.
Il
l’a frottée.
Avec
sa peau.
Il
a touché de ses mains souvent la peau qu’elle avait sur les os.
C’est
une zone sensible, l’absence qu’il lui a laissée sur tout le corps.
Une
surface sans fond, échauffée de haut en bas.
Irritée
de part et d’autre.
Toute
froissée.
Sa
peau qui l’enveloppe essaye de fermer les yeux pour somnoler pendant quelques
années.
Elle
reste longuement seule à se regarder.
Il
ne pouvait plus la voir.
Elle
passe la paume de la main sur ses organes, les uns après les autres.
Toucher
ce qu’il lui a laissé.
Toucher
ses restes, ceux qu’elle peut identifier, ceux qu’elle peut dénombrer.
Elle
n’ose pas penser à ceux qui lui font défaut.
Il
a dû en emmener quelques-uns avec lui.
Par
inadvertance.
Ou
par intérêt.
Elle
ne peut plus se servir d’elle-même parce qu’il en a eu trop l’usage.
Elle
manque, maintenant qu’il a tout pris sans demander, elle manque de substance.
Emplir,
emplir, vite, les poches sous ses yeux qu’elle ferme encore une fois.
Elle
reste coude à coude avec le plancher qui l’appuie.
Elle
est pensante à demi.
Pesante
en entier.
Certainement,
il ne pouvait plus la supporter.
Et
depuis son départ, c’est à elle de maintenir le poids dont elle devait
l’accabler.
Elle
voudrait fondre.
Debout
face au plafond.
Elle
veut encore s’alléger, allongée dos au sol.
Se
décharger par terre de la masse impossible de sa tête qui penche de plus en
plus, jusqu’à tomber dans l’oubli.
Il
lui est nécessaire de se coucher.
De
s’allonger sur le flanc.
Pour
chercher à retrouver, sous chacune des plaques altérables où le sol se soulève,
la dure et fidèle matière des choses qui se tiennent.
Elle
s’arrondit et pose une à une ses vertèbres le long des plinthes.
Elle
a dû trop gémir, ce n’est plus nécessaire.
Elle
était alors occupée à courir après eux.
Il
lui disait de s’arrêter, elle a dû trop courir.
Elle
l’appelait à grands cris.
C’était
déjà trop tard.
Elle
est maintenant fixée à son domicile sans plus émettre aucun son.
Il
ne lui appartient plus de devoir s’exprimer.
Elle
n’est plus personne.
Il
est très fort.
Et
lourd, son poids l’a terrassée.
A
plat.
Elle
a entendu l’heure passer juste sous elle.
Et
puis la suivante.
La
suivante, juste une heure.
Elle
baisse les paupières pour filtrer soigneusement sa mémoire qui la traverse sans
arrêt.
D’heure
en heure.
C’est
beaucoup trop long.
Elle
soulève la tête et demain commence un défilé, toute l’avenue de la nuit et du
jour et de la nuit et du jour.
Rien
que de l’avenir devant elle.
Comme
c’est éprouvant.
Et
comment aurait-elle pu savoir qu’il l’emporterait avec lui.
Accrochée
tout autour de ses épaules.
Elle
pensait devoir le vouloir pour toujours.
Continuer
d’avoir à le suivre pour aller d’un point à un autre.
Elle
ne sait plus où elle va.
Il
est sorti de sa vie et elle n’en pèse pas les conséquences.
Elle
marche, suivant les pas qui laissent leurs traces sur le papier peint.
C’est
un progrès.
Ils
vont l’emmener quelque part.
Même
si, quelque part, il n’y est pas.
Là
ou ailleurs, un jour c’est sûr, ça n’aura plus d’importance.
Il
l’a laissée tomber et elle est assise devant ce qu’elle ignore.
L’art
délicat de se porter.
De
s’emporter.
De
bien se comporter avec soi pour éviter de s’oublier tout à fait.
Elle
veut l’oublier et c’est elle qui s’oublie sous lui.
Car
depuis son départ, elle suit laborieusement les pensées qui la précèdent.
Il
marche en avant, devant elle, tout occupée à oublier qu’il détient ses pensées.
Elle
cherche à les joindre, à les rassembler.
Elle
sent bien qu’elle erre.
Elle
craint la désintégration de son organisme par ces pensées qui l’extraient
d’elle sans arrêt.
Elle
redresse le menton et pense à autre chose pour s’assurer qu’elle a encore un
peu d’espace.
C’est
une parade.
Le
danger est là.
Ses
pensées se séparent de son tronc desséché et se posent librement là où c’est impossible.
Juste
au milieu des questions qu’il aurait dû emmener en partant mais qu’il a préféré
poser ici.
Devant
elle tombe sans discontinuer une fine pluie d’énigmes.
Qu’aurait-elle
dû répondre ?
Qui
devait expliquer ?
C’est
trop tard.
Il
lui a mis la main sur la bouche en lui fermant tout accès à l’extérieur
d’elle-même.
Elle
est obéissante.
Elle
se tait en tête-à-tête avec l’angle où seul l’écho de sa digestion résonne.
Elle
secoue la tête et reste donc là.
Où
pourrait-elle se fuir ?
Elle
décide de se lever, de se laver, d’avaler sa salive.
Marcher
d’abord par à-coups pour vérifier où se trouve maintenant le centre de sa
gravité.
Marcher
et avancer dans tous les interstices libérés par sa présence en creux.
Ils
sont peu nombreux.
Lente
et concentrée.
Cela
doit être possible.
Marcher
au hasard dans cet appartement et se laisser guider par l’aptitude à l’oubli.
Elle
sommeille depuis si longtemps.
Elle
n’a plus d’instinct distinct.
Elle
n’est qu’une masse.
Une
femme allongée au milieu de ses morceaux informes, immobilisée horizontale au
sommet de la stèle de ses vieux sentiments.
Elle
est couchée dans une boîte presque uniquement crânienne.
Elle
a peur du vide.
Il
l’a bien rétamée.
Elle
se cherche à tâtons.
Va
vers les fenêtres pour vérifier si, en bas, là où tous les autres passent,
passe avec eux aussi le temps des accablements.
Elle
ne voit rien.
Elle
n’en est pas certaine.
Elle
tourne.
Derrière,
le mur la suit, sur lequel elle prend tous ses appuis.
Elle
traverse l’air gris de sa mine et se retrouve là.
Et
c’est trop tard.
Elle
se retrouve invariable pour toujours.
Accroupie,
dos au mur.
Pour
toujours au centre.
Là
où l’attire la force de leur gravitation révolue.
Il
ne lui a laissé, au centre, qu’un seul objet.
Qui
la meuble tout entière.
Au
centre de la pièce principale.
Au
centre de ce qui était le lieu de leurs rassemblements et de leurs
agendas décalqués.
Le croisement des passages et des appels.
Lorsqu’il
lui était encore possible de simplement lever la voix pour l’atteindre.
Lorsqu’elle
avait de nombreuses choses à lui dire de toute urgence alors qu’il était assis
sur les toilettes.
Alors
qu’il était debout, son rasoir mécanique à la main.
Ou
s’apprêtant à fermer la porte pour sortir.
Il
est sorti.
Il
est sorti.
Elle
reste enfermée là avec son départ.
Face
au fauteuil qui est le seul objet qui leur appartenait.
Á elle et à lui.
Qu’il
lui a laissé comme un dommage de guerre.
Elle
marche librement à travers les pièces.
Mais
la force d’attraction l’emporte.
Elle
y revient sans décider.
Le
fauteuil la convoque.
Elle
revient sur sa décision d’en finir.
Elle
le savait.
Encore
une fois.
C’était
trop tôt.
Elle
ne peut pas prendre une direction dans cet appartement sans aboutir là, face au
dos de ce fauteuil où il est assis.
Et,
c’est ainsi, elle s’approche de lui.
Elle
doit retrouver la place qu’elle s’est assignée pour un certain temps.
Une
durée.
Des
jours ?
Des
mois ?
Peut-être
pour toujours et elle ne le sait pas.
Elle
se penche.
Elle
penche ses yeux et ses mains.
Elle
se plie.
S’ouvre
et coule le long du dossier.
Pose
les paumes sur le tissu mat de sa nuque fatiguée.
Sans
le vouloir, elle se relâche soudain et s’y repose aussi.
Elle
sort d’elle-même par les narines, elle sort et part à sa rencontre
Et
tout est encore une fois à refaire.
Parce
qu’encore une fois, comme à chaque fois, elle disparaît totalement, sans
laisser la moindre empreinte, dans l’odeur qu’il a omis d’emporter.
Le
parfum de menthe et de moutarde forte qui contamine, lorsqu’elle le porte à son
cerveau, jusqu’à ses dernières chances d’exister.
A Philippe, 2002